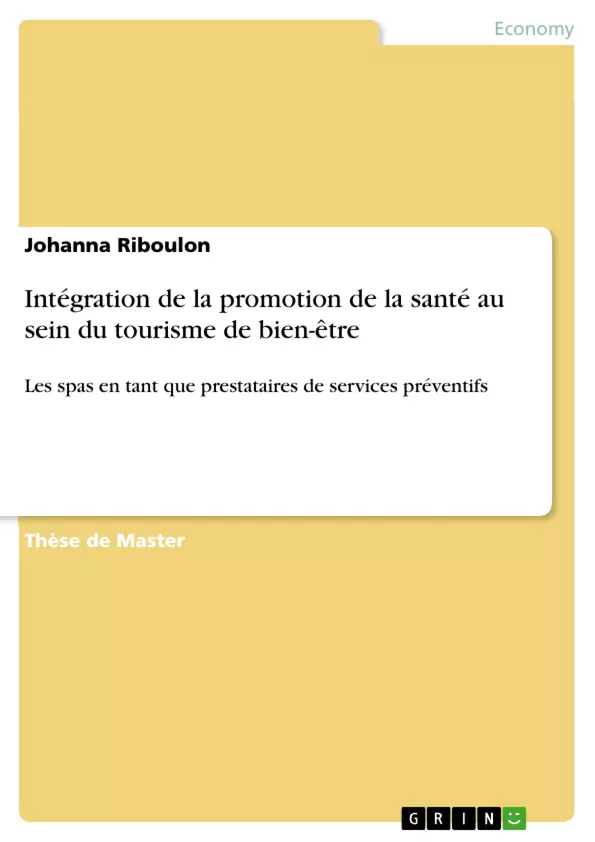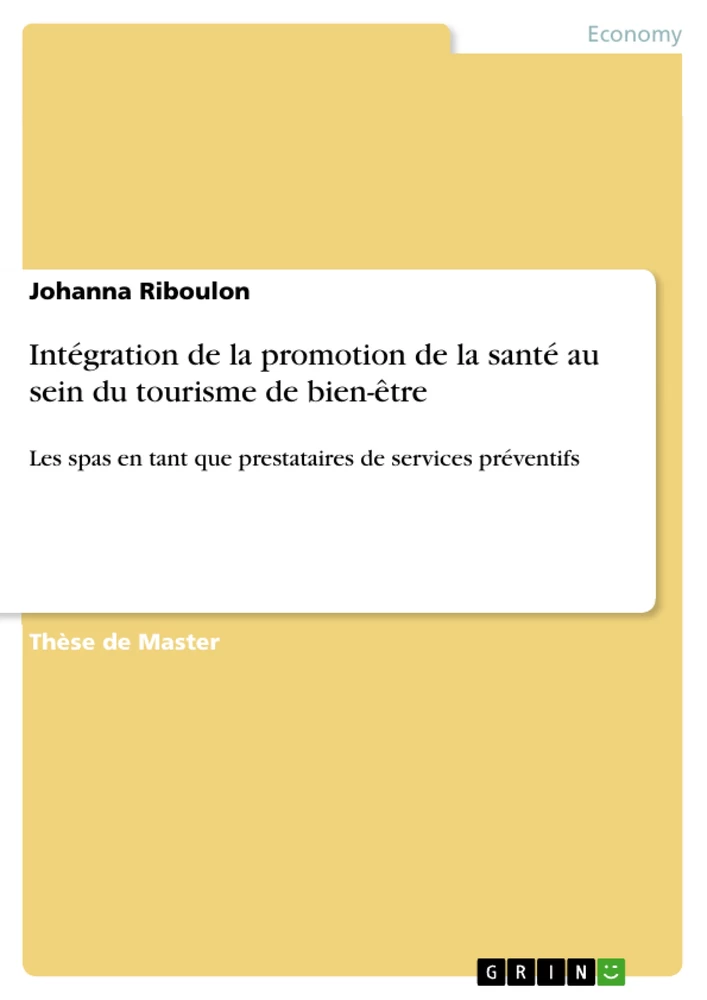
Intégration de la promotion de la santé au sein du tourisme de bien-être
Masterarbeit, 2014
136 Seiten, Note: Mention : très bien
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Introduction
- Le bien-être, une philosophie holistique de la vie
- Définition du bien-être
- Approches du bien-être
- Le bien-être en tourisme
- Les spas, entre luxe et prévention
- L'histoire des spas
- Le développement du marché du spa
- Les différents types de spas
- Les services et prestations proposés par les spas
- Intégration de la promotion de la santé au sein du tourisme de bien-être
- La promotion de la santé
- Le rôle des spas dans la promotion de la santé
- Les enjeux de l'intégration de la promotion de la santé au sein des spas
- Méthodologie de recherche
- Définition de l'objet de recherche
- Choix de la méthode de recherche
- Description de l'échantillon
- Instruments de collecte de données
- Analyse des données
- Résultats de l'enquête
- Le profil des clients de spa
- Les motivations des clients à fréquenter les spas
- Les perceptions des clients sur les services et prestations proposés par les spas
- Les attentes des clients en matière de promotion de la santé
- Discussion
- Les spas comme prestataires de services préventifs
- Les limites et les perspectives de l'intégration de la promotion de la santé au sein des spas
- Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Forschungsarbeit befasst sich mit der Integration von Gesundheitsförderung im Wellness-Tourismus. Sie analysiert, inwiefern Spas als Anbieter von präventiven Dienstleistungen fungieren können.
- Das Konzept von Wellness und seine Bedeutung im Tourismus
- Die Entwicklung des Spa-Marktes und seine Rolle in der Gesundheitsförderung
- Die Integration von Gesundheitsförderung in Spa-Dienstleistungen
- Die Erwartungen von Spa-Kunden hinsichtlich Gesundheitsförderung
- Die Potentiale und Herausforderungen der Gesundheitsförderung im Spa-Sektor
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel definiert das Konzept von Wellness und betrachtet seine verschiedenen Dimensionen. Es untersucht auch die Integration von Wellness in den Tourismus und seine Auswirkungen auf die Tourismusbranche. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Geschichte und Entwicklung des Spa-Marktes. Es beleuchtet die unterschiedlichen Arten von Spas und die Dienstleistungen, die sie anbieten. Das dritte Kapitel analysiert das Konzept der Gesundheitsförderung und seine Rolle im Kontext des Wellness-Tourismus. Es beleuchtet den Stellenwert von Spas in der Gesundheitsförderung und untersucht die Herausforderungen, die mit der Integration von Gesundheitsförderung in Spa-Dienstleistungen verbunden sind.
Schlüsselwörter (Keywords)
Wellness, Spa, Gesundheitsförderung, Tourismus, Prävention, Dienstleistungen, Kundenbedürfnisse, Marktforschung, Branchenentwicklung.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la promotion de la santé dans le secteur du spa ?
Il s'agit de passer d'un "bien-être passif" (simple relaxation) à un "bien-être actif", où le spa propose des services préventifs et encourage les clients à adopter des modes de vie sains sur le long terme.
Pourquoi le tourisme de bien-être est-il important pour le système de santé ?
Face au vieillissement de la population, les systèmes de santé doivent se concentrer sur la prévention plutôt que sur le simple traitement des maladies. Le voyage offre une opportunité idéale pour sensibiliser les individus à leur santé.
Les clients de spa sont-ils prêts à accepter des services de santé préventive ?
L'étude montre qu'une grande partie du public est ouverte à cette intégration, bien que les attentes varient selon le profil des clients et leurs motivations initiales à fréquenter un spa.
Quels types de services préventifs un spa peut-il offrir ?
Les spas peuvent proposer des conseils en nutrition, des programmes d'activité physique personnalisés, des ateliers de gestion du stress et des bilans de santé globaux.
Quels sont les enjeux pour les managers de spa dans cette transition ?
Les enjeux incluent la formation du personnel, la légitimité médicale des prestations proposées et la capacité structurelle des établissements à évoluer vers un modèle hybride entre luxe et santé.
Details
- Titel
- Intégration de la promotion de la santé au sein du tourisme de bien-être
- Untertitel
- Les spas en tant que prestataires de services préventifs
- Veranstaltung
- Management des organisations, du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs
- Note
- Mention : très bien
- Autor
- Johanna Riboulon (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2014
- Seiten
- 136
- Katalognummer
- V283106
- ISBN (Buch)
- 9783656824145
- ISBN (eBook)
- 9783656824152
- Dateigröße
- 2808 KB
- Sprache
- Französisch
- Schlagworte
- tourisme de bien-être promotion de la santé industrie du spa prévention wellness tourism healthcare promotion spa industry
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 15,99
- Preis (Book)
- US$ 36,99
- Arbeit zitieren
- Johanna Riboulon (Autor:in), 2014, Intégration de la promotion de la santé au sein du tourisme de bien-être, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/283106
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-