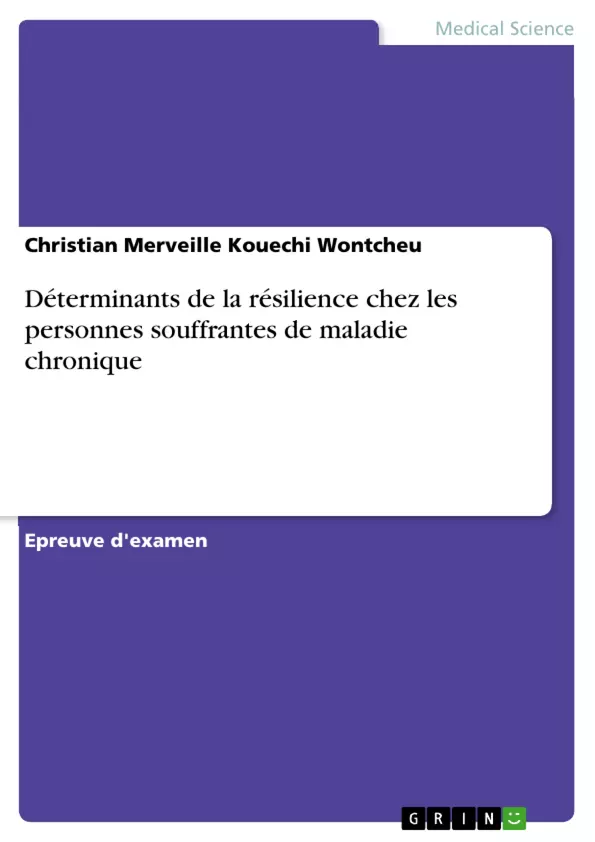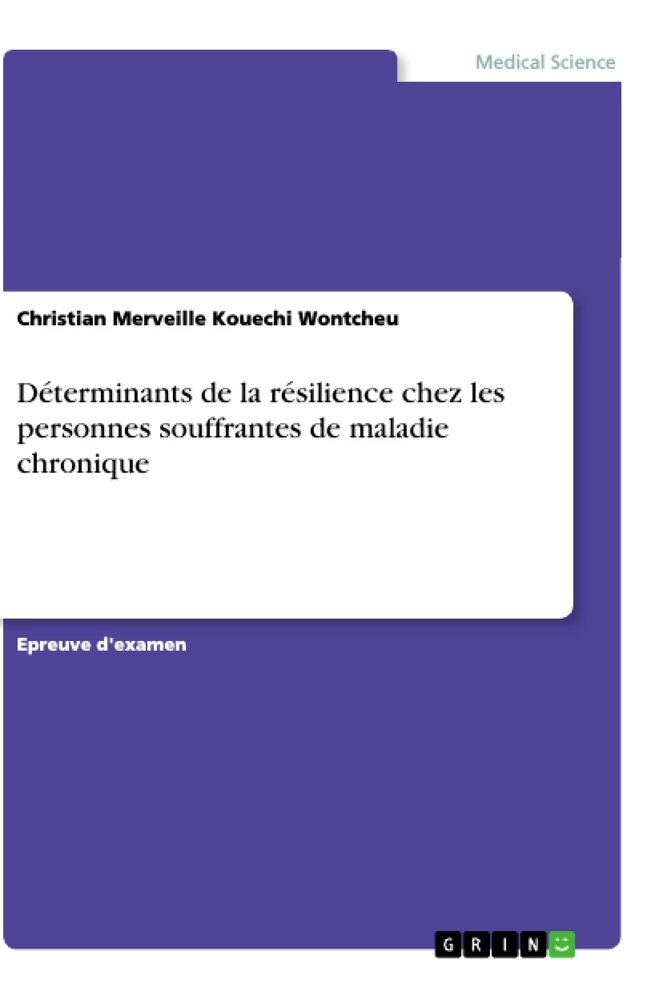
Déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique
Examensarbeit, 2020
97 Seiten, Note: 18,00
Leseprobe
SOMMAIRE
DÉDICACE
Remerciements
Liste des abréviations, acronymes et sigles
Listes des figures
Liste des tableaux
Résumé
Abstract
Introduction
Chapitre 1 : État de la question
Chapitre 2;: Cadre de l’étude
Chapitre 3;: Approche méthodologique
Chapitre 4;: Présentation et analyse des résultats
Chapitre 5;: Synthèse et discussion des résultats
Conclusion
Suggestions formulées au regard des problèmes
Références Bibliographiques
Annexes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Remerciements
À l’acheminement de ce travail nous n’oserons débuter sans toute fois rendre grâce à Dieu Tout Puissant pour ses merveilles dans nos vies, sa protection et la force qu’il a daigné nous accordé tout au long de la rédaction de ce travail.
Nous tenons à exprimer notre gratitude à Madame Christelle;MAGOUE notre coordonnatrice pour avoir diriger rigoureusement ce travail, son soutien moral et sa disponibilité tout au long de ce travail. Nos remerciements vont aussi à l’endroit;de:
- Des promoteurs du CPFPMS de Mbouda M. Jonas MOUAFO et M. Pierre NGANKEU pour leur dévouement à notre réussite.
- Du directeur M. André DIFFO, l’ensemble du corps administratif;et enseignants du CPFPMS Fondation Monga de Mbouda pour leurs enseignements, leurs encouragements et leurs encadrements.
- M. Franklin TENE, M. Félicité TOUOTAP et M. ulrich KUENANG nos ainés dans la profession pour leur multiple apport constructif dans la méthodologie.
- Nos parents M. & Mme. KOUECHI pour leur soutien incommensurable sur le plan spirituel, psychologique et financier, les multiples conseils;inestimables.
- Mme. WOUKOUATCHEU Gertrude Flore pour son soutien moral et matériel.
- Mélissa DAPENOU pour son soutien multiforme.
- Nos amis BAKAVA, MONKOUOP, DJIMELI, LONTSI, TCHAMBOU, DONLEFACK, TSEMO, TSAYEM,;SAPE, TIAYA, DJUISSIE, KENNE et tous nos camarades de promotion pour les encouragements et leur disponibilité.
- Tous ceux dont les noms ne figurent pas, trouvez en ce travail l’expression de ma profonde gratitude.
Liste des abréviations, acronymes et sigles
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Listes des figures
Figure 1: Modélisation des déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique
Liste des tableaux
Tableau I;: Répartition du personnel de l'hôpital de district de Mbouda
Tableau II: Répartition du personnel de l'hôpital AD-Lucem de Mbouda
Tableau III: Répartition du personnel de l'hôpital protestant de Montchio
Tableau IV: Caractéristiques sociodémographiques
Tableau V: Suggestions formulées au regard des problèmes rencontrés
Résumé
Les maladies chroniques constituent un problème majeur de santé publique dans le monde, représentant la première cause mondiale de mortalité. Avec le vieillissement poussé des populations et les progrès scientifiques, la multiplication de ces maladies n’est plus à démontrer. Ces personnes atteintes, confrontées à diverses adversités qui émergent de la maladie, très souvent invalidante ou en constante évolution suscite l’intérêt d’une prise en charge pressante, adaptée et holistique. Elle est d’autant plus préoccupante pour la personne atteinte car influence grandement sa vie sociale, professionnelle et familiale. Fort de ces répercussions multiples et du caractère impérieux que pose le défi d’une adaptation des systèmes de santé pour des soins de qualités, il nous a parue donc important de questionner le phénomène de résilience des personnes à maladie chronique. Pour s’y atteler, une étude qualitative de type descriptif a été menée à travers une collecte de données effectuée à l’aide d’un guide d’entretien auprès des personnes résilientes souffrantes de maladie chronique dans les hôpitaux de la ville de Mbouda. Notre population était constituée de dix personnes dont le nombre a été arrêté par l’atteinte du niveau de saturation. Les données recueillies ont été traitées par analyse de contenu qui a permis de ressortir les ressources personnelles et contextuelles de résilience chez ces personnes. Les résultats de la recherche ont montré que la bonne estime de soi (autonomie), la prière, l’hyper Optimisme, les expériences de vie, le positivisme, la bonne approche dans l’annonce de la maladie, la bonne cohésion familiale, la bonne communication, la prise en soin financier et psychologique représentent autant de ressources à l’origine de résilience des personnes souffrantes de maladie chronique.
Mots-clés;: Déterminants, Résilience, Maladies Chroniques.
Abstract
Chronic diseases are a major global public health problem, representing the world's leading cause of death. With the advanced ageing of populations and scientific progress, the increase in the number of these diseases is no longer in doubt. These sufferers, confronted with various adversities that emerge from the disease, very often disabling or constantly evolving, raise the interest of an urgent, adapted and holistic care. It is all the more worrisome for the person with the disease because it greatly influences their social, professional and family life. In light of these multiple repercussions and the imperative nature of the challenge of adapting health care systems to provide quality care, we felt it was important to question the phenomenon of resilience among people with chronic disease. To do so, a descriptive qualitative study was conducted through data collection using an interview guide with resilient people suffering from chronic disease in hospitals in the city of Mbouda. Our population consisted of ten people whose numbers were stopped when saturation levels were reached. The data collected was processed by content analysis, which made it possible to highlight the personal and contextual resources of resilience in these people. The results of the research showed that good self-esteem (autonomy), prayer, hyper-optimism, life experiences, positivism, the right approach in announcing the illness, good family cohesion, good communication, and financial and psychological care are all resources that contribute to the resilience of people suffering from chronic illness.
Keywords: Determinants, Resilience, Chronic Diseases.
Introduction
Vivre avec une maladie chronique ou invalidante est un long processus de maturation, durant lequel la personne et sa famille doivent passer au travers plusieurs étapes associées au processus de deuil. Deuil de sa santé, deuil de la personne qu’elle était avant la maladie (vie sociale et professionnelle).;Ce changement de rôle social;entraine une quête existentielle et spirituelle, confrontant à la nécessité de consentir des renoncements voire être privé de capacité décisionnelle. À chacune des étapes du processus, elle devra développer des stratégies qui lui sont propres pour ultimement assumer sa nouvelle situation et réussir à modifier son projet de vie.
Cependant les répercussions de ce phénomène redoutable retrouvé dans le monde en général et au Cameroun en particulier sembleraient être les précurseurs des décès précoces chez certains. Toutefois d’aucuns parviennent à conserver leur stabilité psychique et une qualité de vie malgré les évènements déstructurants et les épreuves traversées, processus par lequel ces personnes deviennent résilientes.
Une récensions des écrits pour ce phénomène dans notre contexte, dégage un déficit de recherche sur ce sujet. En raison du risque morbide lié à la charge de l’affection sur l’individu, il nous a paru nécessaire de mener une investigation autour de la question;: «;Quelles sont les ressources résilientes des personnes vivant avec des MC ?;». Ce qui appellerait ainsi des dispositifs ou des innovations pour y adapter des solutions de prise en charge fondée sur la résilience des personnes concernées, et autant que possible personnalisées. Nous nous sommes inscrits dès lors dans une démarche qualitative de type descriptif autour de la thématique des «;déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique;: cas des hôpitaux de la ville de Mbouda ». Ce travail se déclinera autours de cinq principales articulations qui sont entre autres l’état de la question, le cadre de l’étude, l’approche méthodologique, la présentation et l’analyse des résultats et enfin la discussion et la synthèse.
Chapitre 1 : État de la question
La santé est une entité très complexe et dont le champ ne cesse de s’élargir. Elle reste une question primordiale dans la vie de l’être humain, car c’est un bien qui a autant d’importance pour lui. Mais en même temps, il est considéré comme le processus le plus mal gardé lorsqu’il est affecté par une maladie chronique ou invalidante. Ce changement plutôt bouleversant dans la vie de la personne atteinte de ce type de maladie demande beaucoup d’implication de celle-ci ou des proches aidants. Pour réussir à s’adapter à sa nouvelle situation, elle a besoin du soutien des professionnels de la santé afin de l’accompagner à développer grâce à ses propres ressources une capacité de rebond positif de sa vie en dépit de l’adversité et donc une résilience. Ce chapitre traite de quelques contextes dans lesquels le phénomène se manifeste, du problème qu’il soulève, de l’état des connaissances et de la perspective théorique dans laquelle s’inscrit cette étude, des questions et objectifs de recherche, et de l’intérêt qu’il y a à mener une étude sur les déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique.;
1.1 Contexte de l’étude
Les maladies chroniques (MC) sont définies comme des problèmes de santé sérieux qui nécessitent une bonne prise en charge dans le suivi des changements proposés des habitudes de vie, dans les traitements (bromeling et al 2008; Cazale & Dumitru, 2008; Dubé, 2012; Hamel et al., 2005) ainsi que dans le soutien à l’autogestion (Conseil canadien de la santé, 2012). L’augmentation rapide de la prévalence des MC au sein de la population n’est plus à démontrer. Elles sont en grande partie, responsables d’une diminution de la qualité de vie, en plus d’être une cause importante de mortalité précoce (bromeling et al 2008; Wagner et al., 2001).
Avec le vieillissement des populations, il est essentiel d’optimiser la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques (MC) et ce, dans une optique où cela devrait être une préoccupation majeure des gouvernements (bromeling et al 2008; Wagner et al., 2001). Les MC constituent le principal problème de morbidité à l’échelle mondiale, puisqu’elles sont responsables de 63 % des décès (Mireau, Gaudreault, & Laframboise, 2011 ; Organisation mondiale de la santé, 2006). Elles ont des impacts importants sur les personnes atteintes et leurs proches, sur le système de santé ainsi que sur l’ensemble de la société. Il faut donc tenter de modifier l’organisation des soins actuels en vue de mettre l’emphase sur l’auto prise en charge individuelle (autogestion) des personnes atteintes de MC fondé sur une approche résiliente.
Pour Dubé et al. (2012) les statistiques sont probants et l’augmentation croissante du risque d’atteinte serait une conséquence explicite de l’exposition aux facteurs de risque d’une population vieillissante. Si la tendance se maintient et qu’il y a recrudescence des facteurs de risque modifiables (sédentarité, embonpoint et obésité, tabagisme et alimentation inadéquate), le fardeau des MC devrait s’alourdir autant pour les personnes que pour les intervenants (Cazale & Dumitru, 2008; Hamel et al., 2005; Wagner, 2001). La prévention de ces MC devient alors le moyen le plus efficient pour la suppression les effets négatifs que ceux-ci peuvent apporter. ;Nous ne saurons assez mesurer toute la portée des maladies invalidantes, stigmatisantes et dévalorisantes autant au niveau de la qualité de vie et de l’espérance de vie des personnes atteintes que pour celle des proches aidants.
Parmi ces maladies figurent les maladies chroniques non transmissibles (MCNT), telles que : le diabète, l’arthrite rhumatoïde, l’arthrose, les maladies obstructives pulmonaires chroniques (MPOC), l’hypertension, les maladies vasculaires cérébrales, l’insuffisance cardiaque et les cardiopathies ischémiques entre autres (Dubé et al., 2012). En 2012, les MCNT étaient les principales causes de décès dans le monde, correspondant à 68% des décès (OMS, 2014). ;Environ 75% des décès dus aux MCNT surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Quarante pour cent d'entre eux sont prématurés, c'est-à-dire qu'ils surviennent chez des personnes âgées de moins de 70 ans. La plupart de ces maladies apparaissent de façon insidieuse et ont une évolution lente, ce qui a comme résultat une diminution de l’observance thérapeutique (Corser & Dontje, 2011; de la Santé, 2011; Singh et al., 2006). Les personnes atteintes de MC ont souvent plus d’une condition médicale (deux pathologies ou plus). On parle alors de multimorbidité, ce qui complique la prise en charge globale de la personne en ajoutant une complexité à la continuité des soins (Guthrie, s.;d.)(Fortin et al., 2005 ; Russell et al., 2009).
De plus, la prévalence élevée de la multimorbidité, définie par la présence de deux MC ou plus (Fortin, et al., 2005), requiert de repenser le système actuel de gestion des MC(Guthrie, s.;d.). Celui-ci est axé davantage sur la maladie, alors qu’il devrait s’orienter vers une approche globale et complète de la personne. À l’échelle de la planète, les chiffres donnent le vertige. Entre 1980 et 2014, le nombre de diabétiques est passé de 108 à 422;millions, affirme l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2014). Quatorze;millions de personnes sont par ailleurs touchées chaque année par un cancer, un chiffre qui devrait augmenter de 70;% dans les deux prochaines décennies, craint l’organisation onusienne (Les maladies chroniques bousculent la médecine, s.;d.). Entre 2010 et 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2011) prévoit une augmentation des maladies non transmissibles de l’ordre de 15% à l’échelle internationale. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la croissance économique d’un pays et les divers leviers de développement des nations. Si l’on ne fait rien, 388 millions de personnes mourront de maladies chroniques au cours des 10 prochaines années (ibid.). Beaucoup de ces décès surviendront de façon prématurée, touchant les familles, les communautés et les pays. Leurs répercussions macroéconomiques seront importantes. Des pays comme la Chine, la Fédération de Russie et l’Inde pourraient voir amputer leur revenu national de $200 à $550 milliards au cours des 10 prochaines années du fait des cardiopathies, des accidents vasculaires cérébraux et du diabète (Pixl 8, s.;d.). Le vieux continent quant à lui ne serait pas en reste face à cette poussée de MC.
Le cancer, le diabète, les troubles mentaux et les maladies respiratoires provoquent 86 % des décès en Europe. Environ 4 millions d’Européens et 1,5 million de citoyens de l’UE (Union Européenne) décèdent à la suite de maladies cardiovasculaires chaque année (le Réseau européen du cœur et la Société européenne de cardiologie, 2006).; Les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont les formes les plus répandues de maladies cardiaques (Organization, 2014). Selon un rapport publié en;2011 par le Groupe ressource;sur les problème cardio-vasculaires;(Cardiovascular resource group), dans les cinq plus grands pays de l'UE (Allemagne, France, Italie, Espagne et Royaume-Uni) 133,3;millions de personnes souffrent d'un mauvais cholestérol trop élevé, ce qui correspond au niveau de la maladie aux États-Unis (135,1;millions de personnes). Selon les estimations présentées dans Panorama de la santé : Europe 2016, le décès prématuré de 550 000 personnes d’âge actif des suites de maladies chroniques (crises cardiaques, AVC, diabète ou cancer). Cette croissance régulière du nombre de malades durant ces dernières années représente non seulement une véritable tragédie humaine, mais est également coûteux en terme de prestation de soin soit 115 milliards EUR par an aux pays de l’UE (Les maladies chroniques font payer un lourd tribut à l’Europe, selon un nouveau rapport de l’OCDE et de la Commission européenne - OCDE, s.;d.).
En France comme ailleurs, l’inflation des maladies chroniques tourne à l’épidémie. Vingt millions de personnes souffrent de maladies chroniques, soit un tiers de la population. Dix millions d’assurés du régime général, soit 17;% de sa population, sont inscrits en affection de longue durée (ALD), ce qui signifie qu’ils sont atteints d’une des vingt-neuf affections pour lesquelles la prise en charge est effective (Les maladies chroniques, s.;d.). Leur effectif a doublé depuis vingt ans, comme l’a souligné la cour des comptes, mais il est loin de refléter l’ensemble des personnes atteintes de maladies chroniques. Les maladies infectieuses ne représentent plus que 2 % des décès en France. Les maladies chroniques sont devenues un véritable problème de société, les maladies chroniques non transmissibles comptent pour 88 % des décès en France. On comptabilisait 107 307 décès « prématurés » en 2005, c’est-à-dire survenant avant 65 ans, toutes causes confondues (Briançon et al., 2010).
Chaque année, environ 160 000 personnes au Canada meurent des causes de la maladie cardiovasculaire, du cancer, de la maladie pulmonaire et du diabète, ce qui représente les deux tiers du bilan des décès annuels (Comité consultatif sur la santé de la population, 2002). Selon le recensement de 2006, plus de quatre millions de personnes étaient âgées de plus de 65 ans, soit 14% de la population. De ces aînés, 89 % présentaient au moins un problème de santé chronique et le tiers souffrait de problèmes multiples (L’Administrateur en chef de la santé publique, 2010). Quarante-quatre pour cent des personnes âgées de plus de 20 ans avaient au moins une maladie chronique en 2009-2010 (Organisation mondiale de la santé, 2011). Ces statistiques devraient s’accroître avec l’augmentation de l’espérance de vie des individus et la recrudescence de facteurs de risques, tel le tabagisme, la sédentarité et la malnutrition (Conseil canadien de la santé, 2007). Les MC sont souvent considérés comme des problèmes de santé publique d’importance seulement dans les pays développés en réalité. Cependant, seulement 20 % des décès par MC se produisent dans ces pays, alors que les chiffres sont alarmants, près de 80 % des personnes qui meurent des maladies chroniques et des maladies non transmissibles vivent dans le monde en développement. 80 % surviennent dans les pays en développement où la grande majorité de la population mondiale vit.
Les infections mortelles, comme l’infection à VIH, le paludisme, la tuberculose, le choléra, la dysenterie et les fièvres hémorragiques comme celles d’Ebola et la fièvre jaune, ont toujours mis à rude épreuve les systèmes de santé du continent africain. Aujourd’hui, la brusque augmentation des maladies non transmissibles, comme le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires (MCV) et pulmonaires, qui sont liées à la mondialisation et à l’évolution de l’économie font peser une charge supplémentaire sur ces systèmes. Ces maladies, connues sous le nom de maladies non transmissibles (MNT), tuent chaque année 41 millions de personnes, ce qui représente 71 % des décès dans le monde (OMS, 2018) (Non Communicable Diseases, s.;d.). En 2015, les conditions d’infections en Afrique représentaient 5,2 millions de décès (56,4%), contre 5,7 millions en 2010 (61,4%). Les maladies non transmissibles, traditionnellement associées à l'urbanisation et à des niveaux de vie plus élevés, représentaient 3,1 millions de décès (33,5% de tous les décès), contre 29,4% en 2010 («;LES MALADIES CHRONIQUES DE L’AFRIQUE AFRIKA NEWS;», 2020). La situation sanitaire de l’Afrique ne cesse de se détériorer. L’OMS estime que les maladies non transmissible (MNT) augmenteront de 27 % au cours des 10 prochaines années sur ce continent et seront responsables de 28 millions de décès supplémentaires. Cela représente une augmentation globale de 17 % au cours de cette période. D’ici à 2030, la mortalité par maladies non transmissibles en Afrique devrait dépasser celle des maladies contagieuses, maternelles, périnatales et nutritionnelle prises dans leur ensemble (L’augmentation galopante des maladies chroniques en Afrique - Sanofi, s.;d.).
Le Sénégal ne fait pas figure d’exception sur le continent. En effet, si les principales maladies mortelles demeurent les infections des voies respiratoires (101,8;morts pour 100;000;habitants), le VIH (76,8) et les maladies diarrhéiques (65 morts), elles sont désormais talonnées par les accidents vasculaires cérébraux (44,6) et les maladies cardiovasculaires (44,5). Ces maladies chroniques sont aujourd’hui responsables de plus 41% de décès devant le paludisme et la tuberculose (OMS, 2014). Mais alors que la mortalité liée aux maladies transmissibles a enregistré une baisse significative entre 2000 et 2015 (– 66;% pour le paludisme, – 57;% pour le sida et – 52;% pour les maladies diarrhéiques), celle provoquée par des maladies non transmissibles, liées au mode de vie et à l’environnement quant à elles stagnent («;Ces nouvelles maladies qui sévissent en Afrique;», 2019) .
En République démocratique du Congo (RDC), près d’un adulte sur quatre serait à haut risque des MNT (Enquête démographique et de santé [EDS-RDC], 2008). En effet, la prévalence de l’hypertension (HTA) tant en milieu rural qu’urbain se situe entre 25 et 30 % (Krzesinski & Xhignesse, 2007). Selon Katchunga et al (2010) à l’Est de la RDC, 57,5 % des hypertendus n’étaient au courant de leurs maladies et seulement 13,6 % avaient un suivi médical. Dans une autre zone de santé semi-rurale de la RDC, la protéinurie (micro-albuminurie et macro-albuminurie) était fréquemment détectée pendant le dépistage du diabète, de l’obésité et l’hypertension et était particulièrement associée aux patients de plus de 60 ans. Or, la gestion intégrée du diabète est essentielle pour prévenir l’insuffisance rénale seconde à une comorbidité diabète-hypertension dans cette population (Makulo et al., 2010).
Le Cameroun, comme d’autres pays en développement connait maintenant le double fardeau des maladies infectieuses et chroniques, les maladies non transmissibles (MNT). Le fardeau des maladies infectieuses est largement tiré par le paludisme, le VIH/sida et la tuberculose. La flambée des maladies chroniques combiné aux maladies aigues dans la même population, rend ce fardeau plus lourd au moment où la demande dépasse largement l’offre limitée. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2010), les maladies non transmissibles (MNT) au Cameroun (y compris les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires et les cancers) ont représenté environ 31 % de tous les décès en 2008. Les maladies non transmissibles les plus répandues au Cameroun sont les maladies cardiovasculaires, qui représentent 14 % du total des décès dans tous les groupes d’âge en 2008. Dans la même année, les maladies non transmissibles variantes de maladies respiratoires, cancers et le diabète ont contribué respectivement 4 %, 3 % et 2 % de la mortalité totale. Un article récent de Lekoubou et al (2010)montre que la prévalence de l’hypertension a augmenté entre deux et cinq fois chez les hommes et les femmes camerounaises ruraux et urbains entre 1994 et 2003. Plus précisément, la prévalence normalisée selon l’âge de l’hypertension a presque doublé, passant de 20,1 % à 37,2 % chez les femmes et de 24,4 % à 39,6 % chez les hommes. Il y a une pénurie de données nationales sur la fréquence et les tendances des cancers. Toutefois, selon un certain nombre d’études en milieu hospitalier, tant pour les hommes et les femmes, les cinq cancers les plus fréquents sont le sein, le col de l’utérus, le foie, lymphome non hodgkinien et la prostate. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes avec une incidence et de la mortalité taux normalisé selon l’âge de 19,2 et de 15,2 par 100;000 personnes par an respectivement. Les cancers du sein et du col utérin sont les tumeurs les plus fréquentes chez les femmes. Les incidences et la mortalité normalisées selon l’âge sont de 27,9 et 16,6 pour 100.000 personnes par an pour le cancer du sein et 24 et 19 par 100;000 personnes par an pour le cancer du col utérin. En 2010, le nombre estimé de décès attribuables au diabète était de 11;852. Selon l’OMS environ 20% de personnes âgées entre 30 et 70 ans au Cameroun sont susceptibles de décéder de l’une de ces quatre maladies chroniques non transmissibles;: c’est l’un des taux les plus élevés d’Afrique sub-saharienne (Foundation, s.;d.).
1.2 Énoncé du problème
Lorsque le diagnostic d’une maladie chronique est établi, la vie du sujet atteint prend une nouvelle tournure. Ce changement nécessite des soins et des interventions adaptés à chaque personne aux différents stades d’avancement de la maladie. Hier encore, on mourait de ces maladies, aujourd’hui, elles nous accompagnent toute notre vie. Ils ont pour particularité de générer des effets catastrophiques sur le plan biologique mais aussi dans le processus de l’acceptation, eux-mêmes sources de conséquences dans les activités de la vie quotidienne.
Les effets catastrophiques des MNT se font plus durement ressentir chez les familles pauvres et chez les enfants. Lorsque le soutien de la famille perd par exemple son aptitude à travailler à cause de la maladie, les ressources s’épuisent rapidement. Cela pousse davantage de familles à la pauvreté et les propulse dans une spirale descendante. Pour atténuer l’impact des maladies non transmissibles sur les individus et la société, il a été pensé une approche globale «;dit la troisième médecine;» pour répondre aux besoins des personnes atteintes de MC. Ainsi, réduire les retombées sociétales de ces maladies. Certaines personnes parviennent à surmonter les difficultés, à suivre le traitement, à faire face aux adversités et malgré tout s’investir et se réaliser grâce à leurs ressources.
Cependant le constat n’est pas le même chez toutes ces personnes, d’aucuns n’arrivent pas toujours à accepter leur situation. C’est donc parmi elles qu’on trouve les patients experts. Mais paradoxalement on ne s’habitue jamais à la maladie, on ne perd jamais le sentiment d’injustice et la colère profonde qu’elle alimente. Les stratégies d’évitement à travers le déni ou encore la perte de la confiance en la vie et la certitude de nouvelles déceptions à venir sont à l’origine chez eux de la non compliance, l’inobservance thérapeutique et d’une qualité de vie difficile pour ne citer que ceux-là.
Conforté dans cette argumentation par le cas du patient amputé non traumatique (pied diabétique) rencontré par le présent investigateur dans l’un de ses nombreux stages d’immersion professionnels qui rétorquait;: « C’est comme si j’étais traversée par un torrent impétueux qui charrie des troncs et des blocs de rochers. À quoi bon continuer d’exister sans vie professionnelle;? je suis imbu de ma propre personne définitivement marqué du sceau de la mort…figure toi que mon corps exhalait des odeurs de décomposition avant l’intervention opératoire… non, je dois mourir pour ne plus être un fardeau pour mes proches qui subisse tout cela;à cause de moi ». ;;Ce découragement, cette passivité, ce laxisme voire cet appel au suicide, interpellent le questionnement sur les déterminants de la résilience de ces personnes.
1.3 Problématique
La problématique de recherche pour Donald Long (2004) est souvent perçue et enseignée comme une démarche systématique qui, une fois suivie, débouche inévitablement sur la formulation d’hypothèses appropriées, pertinentes et logiques. Plusieurs auteurs ont proposé une conception de la problématique de recherche. La plupart conçoivent la problématique d’une recherche comme un processus ordonné de raisonnement qui prend ses énergies vitales de la recension des écrits. Selon Quivy et al (dans Nkoum, 2010) la problématique est « l’approche ou la perspective théorique qu’on décide d’adopter pour traiter le problème posé par la question de départ ». Le sujet de déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique est un sujet complexe car faisant intervenir de nombreux protagonistes (personnel soignant, patient, famille, système de santé). Cette thématique est abordée ici sous l’angle des sciences infirmières et précisément dans le paradigme de la transformation qui met l’accent sur le patient en tant qu’acteur et auteur de soin. À travers une recherche bibliographique dans les bases de données Google scholar, pub Med (en utilisant les descripteurs « pratique infirmière et résilience » ; « résilience et maladie chronique » et « chronic disease ») il semblerait qu’à ce jour aucun chercheur ne s’est intéressé à l’étude du phénomène de la résilience auprès des personnes vivant avec des maladies chroniques au Cameroun et en particulier dans la région de l’ouest (recension des écrits effectuées en janvier 2020). Cette étude semble être ainsi l’une des toutes premières sur le sujet d’où son caractère novateur. Les concepts de « maladies chroniques;»;et de « résilience » serviront de point d’amarrage à la conduite de cette étude. Cette étude adopte une approche clinique qui s’articule autour des dimensions contextuelles et personnelles de la résilience. Celles-ci vont se décliner à travers notre élaboration conceptuelle ainsi que dans nos questions de recherche.
Question de recherche
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelles sont les ressources résilientes des personnes vivant avec des MC?
De cette question de recherche principale émanent deux questions de recherche spécifiques;
1) Quelles sont les ressources personnelles de résilience chez les personnes souffrantes de MC ?
2) Quelles sont les ressources contextuelles de résilience;issues de la qualité de vie des personnes souffrantes de MC ?
Objectifs de recherche
Objectif général de recherche
Déterminer les ressources résilientes des personnes vivant avec des MC.
Cet objectif de recherche ressort également trois objectifs spécifiques
- Ressortir les ressources personnelles de résilience chez celles-ci.
- Identifier les ressources contextuelles de résilience issues de la qualité de vie des personnes souffrantes de MC.
1.4 Intérêt de la recherche
Cette étude a pour but déterminer les ressources résilientes des personnes atteintes de maladies chroniques après avoir évaluer le niveau de résilience chez celles-ci. L’intérêt de notre recherche peut se justifier sur le plan théorique et clinique
THÉORIQUE : Au vue de la recherche documentaire faite, le concept de l’approche résiliente chez les personnes atteintes de maladie chronique est très peu documenté au Cameroun. Une étude sur cet objet contribuera à l’amélioration du niveau des connaissances sur le sujet dans notre pays. Elle permettrait d’identifier les ressources mises en place par le malade et la famille pour faire face à la maladie et l’apport du traitant auprès de ceux-ci au Cameroun et de discuter en fonction des résultats obtenus dans d’autres contextes. Cette étude fournirait un corpus scientifique permettant de comprendre le phénomène de résilience dans notre contexte. Elle pourrait renforcer les connaissances sur les difficultés liées à la conceptualisation et la concrétisation de cette résilience chez ces patients.
CLINIQUE : cette étude à travers des suggestions faites à l’égard de ces structures permettrait d’améliorer la qualité de la relation soignant-soigné, réduire et prévenir les risques de complications, réduire les coûts de soins. Elle contribuerait à éclairer le patient dans sa prise de décision ou de favoriser une attitude positive dans sa réadaptation, elle permettrait aux professionnels de santé de mieux comprendre l’ampleur du problème dans le système de santé du Cameroun et aiderait à identifier les ressources pour la mise sur pieds du processus continue de résilience auprès de ces personnes pour des interventions ciblées et des solutions novatrices.
Chapitre 2: Cadre de l’étude
Ce chapitre définit les concepts clés de notre recherche et présente le modèle d’analyse. Les concepts à dérouler dans ce travail sont;: maladies chroniques et résilience.
2.1 Définition des concepts
Selon Larousse (2019) un concept est une idée générale et abstraite que se fait l'esprit humain d'un objet de pensée concret ou abstrait, et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu'il en a, et d'en organiser les connaissances. Selon NKOUM (2016) un concept est « un mot ou un ensemble de mots qui désigne un ensemble de phénomènes réels. Il désigne aussi idée qui représente une réalité plus ou moins vaste. ».
2.1.1 Maladies chroniques
2.1.1.1 Définition opérationnelle
La maladie, terme généralement identifié par une altération de l’état de santé, ou un état morbide dont la ou les causes sont reconnues ; altération de la santé d’un être vivant. Toute maladie se définit par une cause, des symptômes, des signes cliniques et paracliniques, une évolution, un pronostic et un traitement (Ybert et al, 2001). Selon Quevauvilliers et al (2009), «;la maladie est toute altération de l’état de santé habituellement de façon subjective par des sensations anormales.;» Cependant elle peut être chronique et définit selon l’ENSP (École National de Santé Publique) française (2004, cité par Sager Tinguely et Weber, 2008), « une affection généralement incurable, qui se développe souvent lentement mais dure dans le temps, et qui est constituée de cycles pendant lesquels se succèdent phases aiguës (crises) et phases de stabilisation ou d’évolution de la maladie ». L’OMS (2018) définit la maladie chronique comme étant une maladie non transmissible, de longue durée et à évolution lente.
2.1.1.2 Définition conceptuelle
Pour Rat (2004) la définition de la maladie chronique doit se baser sur les conséquences qu’elle entraîne pour la personne malade. De ce fait, la définition de la maladie chronique devrait supposer :
- Une origine organique, psychologique ou cognitive
- Une ancienneté de trois mois à un an, ou supposée comme telle
- Un retentissement de la maladie sur leur vie quotidienne :
- Avoir une limitation fonctionnelle, de leurs activités ou de la participation
- Présenter une dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un régime, d’une technologie médicale, d’un appareillage, d’une assistance personnelle
- Avoir besoin de soins médicaux, infirmiers, d’aide psychologique, d’éducation ou d’adaptation.
En somme l’investigateur de ce présent travail se propose d’intervenir tout au long de celui-ci auprès des personnes souffrantes de;: ; Maladies cardiaques et vasculaires ( Hypertension artérielle…) ; Maladies endocriniennes;( Diabète…) ; Maladies neurologiques et musculaires;( Antécédent d’accident vasculaire cérébral (AVC)…) ; Maladies rhumatologiques;( Polyarthrite rhumatoïde…) et Maladies du système digestif ( gastrite chronique…) .
2.1.2 La résilience
L’étymologie du mot résilience provient du verbe résilier du latin resilire qui signifie rebondir, rejaillir. Le verbe se compose du préfixe re, qui signifie un mouvement en arrière et de salire qui signifie sauter, bondir (Rey-Debove, 2006). Ainsi, la résilience est le fait de rebondir devant l’adversité. La résilience est, selon Cyrulnik (2005), le processus qui permet de faire la différence entre l’épreuve et le traumatisme. Dans l’épreuve, le sujet reste qui il est, sa personnalité lui permet de se défendre, tandis que dans le traumatisme la personne est submergée par les informations et elle perd le contrôle sur elle-même et sur son environnement. Le terme de résilience est aussi défini comme un « processus par lequel un individu va intégrer et transformer les expériences traumatiques et continuer à se construire sans développer de psychopathologies » La résilience permet à l’individu de s’adapter « aux situations adverses, conditions biologiques et socio psychologiques, grâce à des ressources internes (au sujet) et externes (concernant son environnement) » (FORMARIER & JOVIC, 2009). ;Plusieurs disciplines se sont intéressées à l’étude du concept de résilience, soit à la capacité de rebondir pour continuer d’avancer (Anaut, 2003). À son origine, la résilience était considérée uniquement comme une caractéristique personnelle, mais plus tard elle a été considérée comme étant variable selon les circonstances et jamais absolue ou acquise pour la vie (Manciaux, 2001). Elle se manifeste lors d’une situation difficile telle un traumatisme ponctuel ou répété, une situation à haut risque ou même un handicap permanent (Andreasen et al., 1998; McGarry & O’Leary, 1995;; Vanistendael, 2001). Plus récemment et s’inspirant de la psychologie positive (Seligman, 2011), la résilience a été définie comme étant à la fois un ensemble de caractéristiques personnelles de l’individu, un processus et un résultat. Par ailleurs, sur le plan théorique, le concept de résilience a évolué au cours des années et a donné lieu à la considération de la résilience sur les plans individuel, familial et communautaire.
2.1.3 Types de résilience
2.1.3.1 Résilience individuelle
Les écrits conceptualisent la résilience individuelle selon trois éléments : une capacité, un processus et un résultat.
a) Résilience en tant que trait
Dans une première perspective, la résilience est vue comme le trait de caractère ou la caractéristique propre à l’individu qui promeut la résilience (Anaut, 2006). Selon Richardson et Waite (2002), rattachée à la première vague d’études portant sur la résilience individuelle, plusieurs chercheurs identifient et listent les caractéristiques de personnes résilientes. À titre d’exemples, Werner et Smith (1992) reconnaissent les caractéristiques suivantes chez les enfants résilients : le fait d’avoir une bonne estime de soi, être socialement responsable et bon communicateur. Certains traits sont également présentés comme des facteurs de protection (Fraser, Richman, & Galinsky, 1999; Jacelon, 1997). À l’instar d’un bon nombre d’auteurs (Abelenda & Helfrich, 2003; Fergus & Zimmerman, 2005), la résilience n’est aucunement un trait fixe alors que Barton (2005) nuance quelque peu ce propos en soutenant qu’elle ne se limite pas seulement aux traits ou aux caractéristiques des individus. D’autres auteurs (Fraser et al.,1999; Luthar et al., 2000; Luthar & Zelazo, 2003; Rutter, 2006) rejettent catégoriquement l’idée qu’elle soit un trait individuel. L’adoption d’une telle perspective amène à souligner que le terme résilient ne devrait pas être utilisé en tant que qualificatif pour une personne mais plutôt comme un descripteur de trajectoire de celle-ci (Luthar & Cicchetti, 2000; Luthar & Zelazo, 2003). Luthar et ses collègues (2000) de même que Yates et Masten (2004) avancent que la résilience, comme trait individuel, peut engendrer des conséquences néfastes tel blâmer une personne qui est victime d’une situation. En effet, une personne qui se voit dans l’impossibilité de faire face à l’adversité est alors évaluée comme étant déficiente ou ne possédant pas les bons éléments. Par ailleurs, les écrits incitent à penser que cette première perspective de la résilience individuelle semble faire progressivement place à la seconde.
b) Résilience en tant que processus
Elle est considérée comme étant davantage dynamique à travers le temps. Dans une seconde perspective, la résilience individuelle est vue comme un processus dynamique suivi par l’individu (Anaut, 2009; Cicchetti, 2003; Dyer & McGuinness, 1996; Gilgun, 1999; Harris, 2008; Hawley, 2000; Luthar & Cicchetti, 2000; Luthar et al., 2000; Nakashima & Canda, 2005; Patterson, 2002; Rutter, 2000; Tusaie & Dyer, 2004; Woodgate, 1999; Yates et al, 2003). Ce processus dynamique favorise l’adaptation positive de l’individu confronté à l’adversité c’est dire qu’il répond à ces deux conditions essentielles : il fait face à une menace significative pour lui, à une rude épreuve et sait faire preuve d’une adaptation positive, et ce, malgré les menaces à son propre développement (Luthar & Cicchetti, 2000; Luthar et al., 2000; Ong et al., 2009; Riley & Masten, 2005). En outre, ce processus implique l’interaction entre les facteurs de risque et les facteurs protecteurs tant internes qu’externes de l’individu. Ces facteurs agissent, au fil du temps, en vue de modifier les effets des événements de vie défavorables (Manciaux et al., 2001; Rutter, 1999). Le sens de l’humour et la capacité de prendre des décisions relèvent des facteurs protecteurs internes alors que le soutien conjugal et la présence d’un environnement humain non-punitive relèvent des facteurs protecteurs externes à l’individu (Olsson et al., 2003). Ceux-ci ne sont seulement que quelques exemples car maints facteurs, tant pour la personne que pour la famille, peuvent être répertoriés dans les écrits ; situation amenant certains auteurs à émettre une mise en garde contre cette pratique. Sur ce, Kaplan (1999) précise qu’à un moment donné ou dans un quelconque domaine, des facteurs jugés de protection peuvent être, à un tout autre moment ou domaine, peu ou aucunement utiles ou même devenir des facteurs de risque (Hawley, 2000; Hawley & DeHaan, 1996; Rutter, 1993). À ce propos, Hawley et DeHaan (1996) donnent un bel exemple de facteur lié à la famille. De forts liens familiaux peuvent être un facteur protecteur pour une famille qui compose avec une maladie sévère, mais être un facteur de risque pour une famille dont l’un de ses membres est sur le point de quitter le nid familial. C’est pourquoi Manciaux (2001) avance que : Toute distinction entre les facteurs de risque et les facteurs de protection est souvent artificielle ne serait-ce que parce que le même facteur peut constituer un risque ou une protection, selon les contextes, la nature et l’intensité du stress, selon les personnes, voire les périodes de la vie du même individu. Bien que cette perspective de la résilience en tant que processus soit soulevée dans les écrits, cette conceptualisation de la résilience manque considérablement de clarté. Par exemple, si on considère comme artificielle la distinction faite entre les facteurs de risque et ceux de protection, comment peut-on conceptualiser que le processus de résilience implique l’interaction entre ces mêmes facteurs chez une personne ? Ceci dit, il devient évident qu’un travail de clarification conceptuelle de la résilience en tant que processus est nécessaire pour le développement des connaissances avec une telle perspective.
c) Résilience en tant que résultat
Lorsque la résilience est décrite en termes de résultat, sa relation avec l’adversité est davantage linéaire et déterminée par un ensemble de facteurs internes ou externes à la personne. Selon la troisième perspective, la résilience individuelle est considérée en termes de résultat (outcome) de l’adaptation d’une personne, et ce, en dépit des circonstances, des défis ou des menaces (Mancini & Bonanno, 2009). Quant à Ungar (2004), il la définit comme le résultat qu’obtiennent les personnes suite aux négociations entre les ressources personnelles et celles de leur milieu de manière à pouvoir se définir elles-mêmes en santé en dépit des situations considérées collectivement défavorables. Bien que la notion de résultat ne soit pas toujours présentée clairement, le résultat peut être défini, par exemple, en termes de compétences chez l’enfant telle la réussite académique, l’habileté à entretenir des liens sociaux (Masten et al., 1999; Olsson et al., 2003) ou en termes d’absence de symptômes liés à la santé mentale telles l’anxiété, la dépression (Carbonell et al., 2002). De l’avis de Kaplan (1999), la perspective de résultat défini se veut une limite importante du concept de résilience car elle est liée très étroitement aux jugements normatifs. Toutefois, il appert que l’adoption très claire de l’une des trois perspectives ne soit pas évidente dans les études portant sur la résilience (Glantz & Sloboda, 1999; Luthar et al., 2000; Olsson et al., 2003). À ce sujet, Olsson et ses collègues (2003) tout comme Manyena (2006) constatent même une confusion considérable lorsque le résultat et le processus de l’adaptation sont, à titre d’exemple, utilisés de façon interchangeable pour décrire la résilience. L’examen de la résilience individuelle n’entraîne pas forcément l’exclusion de la famille. Au contraire, selon Hawley (2000), la famille peut être perçue tantôt comme présentant des facteurs de risque tout comme des facteurs de protection pour les individus potentiellement à risque. À l’instar de Walsh (2003), la perception de la famille en tant que facteurs de risque a longtemps été privilégiée dans le passé. Quelle que soit la perspective privilégiée, la résilience demeure un concept qui se prête non seulement bien aux individus mais tout autant aux familles (Glantz & Sloboda, 1999).
2.1.3.2 Résilience familiale
Le concept de résilience familiale fait référence à la résilience, mais cette fois, au sein de la famille en tant que système. De cette perspective systémique, la prémisse sous-jacente est que les crises ou événements très stressants et les défis persistants affectent l’ensemble de la famille et, à son tour, les processus-clés de la famille serviront d’intermédiaire au rétablissement de tous les membres et de leurs relations familiales (Walsh, 2003). Selon Pelchat et Lefebvre (2005), la résilience est définie comme : La capacité de chacun des membres de la famille à se prendre en charge, à être proactif et à s'engager dans le processus de transformation individuel et familial pour faire face à la situation de stress, lui donner un sens constructif et permettre à chacun de trouver un nouvel équilibre afin de participer au renouvellement du bien-être familial. Cela dit, il semble difficile, au même titre que la résilience individuelle, de recueillir, au sein de la communauté scientifique, un consensus en matière de résilience familiale (DeHaan et al., 2002 ; Hawley & DeHaan, 1996). Par ailleurs, le consensus qui ressort est qu’il y a résilience individuelle ou familiale lorsque les individus et les familles affichent une capacité de surmonter les événements difficiles en ayant recours à leurs ressources et à leurs forces acquises et inhérentes (Hawley, 2000). Une chose demeure, tenir compte de la résilience familiale modifie fondamentalement la façon de voir les familles en proie à des difficultés. Plutôt que de les considérer « dysfonctionnelles et irrécupérables », les familles sont perçues comme confrontées à l’adversité ou aux défis de la vie, elles possèdent le potentiel pour favoriser la guérison et le développement de leurs membres (Walsh, 2003). En d’autres mots, et s’intéresser davantage aux manières dont les familles connaissent le succès plutôt que de se centrer sur leurs échecs (Hawley & DeHaan, 1996 ; Walsh, 2003).
2.1.4 Controverse entre résilience et ses concepts connexes
a) Invulnérabilité
L’invulnérabilité est la qualité d’une personne considérée comme non vulnérable c’est-à-dire qui ne peut être blessée ou qui est moralement au-dessus de tout atteinte (Petit Robert, 2008). C’est au cours des années 70 que le concept d’invulnérabilité, et son synonyme l’invincibilité, est utilisé par les chercheurs intéressés par l’adaptation réussie de groupes d’individus, notamment des enfants, exposés à divers facteurs de risque (Anthony, 1974; Werner & Smith, 1989). Peu à peu, la pertinence même des études portant sur l’invulnérabilité est remise en question. Dans les faits, personne n'est totalement invulnérable au stress ni aux événements éventuellement difficiles de sa vie. Ce phénomène englobe aussi bien les personnes qui assument le stress après coup que celles qui n'en sont nullement marquées (Garmezy, 1991). Ainsi, l’invulnérabilité n’est assurément pas synonyme de résilience (Rolland & Walsh, 2006 ; Theis, 2001) car pour qu’il y ait résilience, il doit y avoir présence de difficultés mais aussi vulnérabilité chez la personne qui, affectée par ces difficultés, travaille non seulement à s’y adapter mais à croître à travers elles (Joubert, 2003).
b) Coping
De l’ensemble des termes associés à la résilience, le coping demeure celui qui est le plus souvent évoqué et qui suscite le plus de controverses au sein de la communauté scientifique. Le coping provient de l’anglais to cope traduit par faire face. Bien que le terme coping soit fréquemment utilisé en français, l’Office québécois de la langue française (2010) suggère d’éviter ce terme et de recourir plutôt au terme français adaptation ou son synonyme ajustement. Elle la définit comme « l’ensemble des efforts cognitifs, affectifs ou comportementaux qu'une personne met en oeuvre afin de maîtriser ou de tolérer les tensions internes ou externes qui menacent ou dépassent ses ressources ou ses capacités à s'ajuster à une situation ». Cette définition de l’adaptation (coping) s’apparente à celle prisée dans les incontournables travaux de Lazarus et Folkman (1984). Pour ces derniers, l’adaptation désigne les efforts cognitifs et comportementaux, constamment changeants, destinés à gérer des exigences externes ou internes spécifiques perçues comme menaçantes ou surpassant les capacités d'un individu. En d’autres mots, l’adaptation d’une personne a trait à la mise en place de stratégies d’adaptation, de procédures de régulation essentiellement conscientes élaborées par la personne pour faire face au stress (Anaut, 2004 ; Mackay, 2003). À l’encontre de certains comportementalistes qui minimisent la résilience à l’adaptation (Delage, 2004), le concept d’adaptation renvoie à une acception plus large et ne correspond pas, à lui seul, à la définition de la résilience (Anaut, 2004). Plus qu’un mode d’adaptation, la résilience relève davantage d’un processus d’adaptation. En définitive, l’adaptation n’est pas un synonyme de résilience (Anaut, 2003). Elle est, tout au plus, une composante de la résilience (Aguerre, 2004 ; Manciaux et al, 2001 ; Tomkiewicz, 2000). Il s’avère que la résilience mobilise des ressources encore plus vastes et complexes que celles mises en oeuvre lors de l’adaptation (Aguerre, 2004). Selon Anaut (2003, 2004), cette adaptation ne participe qu’au premier mouvement de la résilience soit la réponse et la tentative pour affronter les problèmes liés au stress ou au traumatisme, donc la capacité d’adaptation. Le deuxième mouvement, celui associé à la résilience, concerne la capacité à continuer à se développer et à augmenter ses compétences dans une situation délétère.
c) Hardiesse familiale
Une similitude est établie entre la hardiesse et la résilience familiales puisque les deux concepts décrivent une réponse à l’adversité (Dyer & McGuinness, 1996) et peuvent être considérés comme un trait (Bonanno, 2004). Par définition, la hardiesse est la qualité d’une personne hardie c’est-à-dire qui manifeste, dénote un tempérament, un esprit prompt à oser sans se laisser intimider (Petit Robert, 2008). Le concept de hardiesse, proposé par Kobasa (1979), est constitué d’un amalgame de trois traits importants chez une personne : le sens du contrôle, le sens de l’engagement et le sens du défi. Ces traits protègent la personne des effets du stress sur sa santé (Kobasa, 1979 ; Kobasa et al, 1982). Par ailleurs, la hardiesse propre à la famille figure parmi les nombreuses composantes du Modèle de la résilience, de l’ajustement et de l’adaptation au stress familial des McCubbin (1996). Au sein de ce modèle, la hardiesse familiale, dite une ressource de l’adaptation, se caractérise par le sens de contrôle quant aux répercussions des événements et des épreuves de la vie (McCubbin, 1996). Elle comprend un engagement partagé de travailler ensemble afin d’affronter et de résoudre le problème et une redéfinition de la famille pour les épreuves de la vie comme des défis (McCubbin et al, 1997). Voilà que dans les écrits, la similitude entre la hardiesse et la résilience est remise en cause (Rolland & Walsh, 2006). Selon Dyer et McGuinness (1996), il s’avère difficile de justifier l’utilisation de la hardiesse, concept comportant des sens de contrôle, d’engagement et de défi auprès de personnes qui en viennent à se développer positivement malgré leurs conditions de vie délétères. À titre d’exemple, un enfant qui a grandi au sein d’une famille abusive, peut-il vraiment voir ce contexte de vie comme un défi à relever ou encore se sentir en contrôle dans un tel contexte ? À ce premier argument s’ajoute celui voulant que la hardiesse se prête aux personnes ou aux familles aptes à supporter l’adversité sans qu’elles connaissent, pour autant, un changement positif contrairement au concept de la résilience (Earvolino-Ramirez, 2007).
d) Facteurs de risque et facteurs de protection
Les facteurs de protection sont des variables, des compétences particulières qui permettent d’améliorer ou de réduire les effets négatifs du risque (Dyer & McGuinness, 1996; Mangham et al, 1995) tels des événements de vie défavorables (Manciaux, et al., 2001; Rutter, 1999). Ceux-ci interagissent avec les facteurs de risque. De cette façon, leur interaction exerce une influence sur la capacité d’adaptation (Golse, 2006) et contribue au potentiel réparateur de la famille (Anaut, 2006).
2.1.5 Facteurs de résilience
a) facteurs contextuels
Trois facteurs contextuels issus des études empiriques apparaissent particulièrement importants à considérer dans l’étude de la résilience individuelle des personnes souffrantes de MC : les relations familiales, le soutien provenant de l’entourage et le sens du « prendre soin ». Les relations familiales semblent occuper une place particulièrement importante dans le phénomène de la résilience. Dans les études empiriques effectuées jusqu’à présent, les chercheurs (Ataie et al, 2008; Jonker & Greeff, 2009) ont conceptualisé les relations familiales en considérant plusieurs dimensions, entre autres la cohésion, la communication, les conflits ou la relation dans la famille et ont montré une association entre la résilience et ces dimensions. Ainsi, dans leur étude, Ataie et al (2008) ont trouvé que la présence des conflits familiaux était associée négativement à la qualité de vie considérée comme un synonyme de la résilience des personnes en perte de mémoire à un stade précoce. Quant à la seconde étude (Jonker & Greeff, 2009) a montré que la qualité de la communication dans la famille constituait un facteur de résilience.
b) facteurs personnels
Le recours aux stratégies de coping et le sentiment d’auto-efficacité, méritent d’être considérés en raison du fait qu’ils peuvent faire l’objet d’apprentissage tout au long de la vie et peuvent ainsi être modifiés par une intervention. Les stratégies de coping réfèrent aux comportements qui favorisent la gestion de la maladie. Ces stratégies peuvent être actives ou passives, centrées sur le problème, sur les émotions ou être des stratégies d’évitement. Seulement, quelques études qualitatives ont trouvé que l’utilisation de ces stratégies était considérée par les répondants comme étant des facteurs personnels de résilience (Cameron & Brownie, 2010; Harris, 2008; Hildon et al, 2008; Jonker & Greeff, 2009; Ross et al, 2003; Tusaie et al, 2007). Quant à l’auto-efficacité, celle-ci se définit comme étant la croyance de la personne en ses capacités à organiser et à exécuter les actions exigées pour gérer les situations spécifiques (Bandura, 1997). Elle influence la motivation, la quantité des efforts et la persistance face aux échecs et aux obstacles, affecte la vulnérabilité au stress et à la dépression, et contribue au bien-être personnel et à la santé (Bandura & Lecomte, 2002).
En somme, ni invulnérabilité, ni facteurs de protection ou de risque, ni hardiesse, ni coping ne peuvent être synonymes à la résilience. La résilience est la capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l’avenir, en présence d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères (Manciaux, 2001) .
2.1.6 La résilience et la maladie chronique
L’annonce d’une maladie chronique comme le diabète, suscite inévitablement une quadruple interrogation angoissante. Face à ce traumatisme, chacun va développer ses propres aptitudes. Évidemment très variables d’une personne à l’autre. Cette possibilité à faire face va dépendre de la capacité à rêver, à relever des défis, à maîtriser son traitement. Elle est liée également à l’existence de projets de vie, d’un soutien social perçu, et le sentiment de compter au moins pour une personne. (Desmet et Pourtois, 2004). Lors de la découverte de sa maladie, le patient va se défendre à sa manière, face au risque d’effondrement psychique ou de dépression. Pour cela, il peut recourir à différents mécanismes comme le déni, le refus de la maladie, la minimisation ou hyper-optimisme, ou encore mettre en place des conduites compensatoires (conduites à risque pour se sentir exister, addictions) et bien d’autres encore...Certes, de tels mécanismes peuvent être efficaces pour résister mais ils ne peuvent constituer autre chose qu’une étape. Si eux aussi deviennent chroniques, ils représentent une deuxième maladie pour le patient. Le malade se rend malade d’être malade. Il faut l’aider à en prendre conscience, à déjouer les ruses de la raison. Il faut surtout qu’il accepte d’en parler pour transformer un destin subi dans le silence, et parfois dans la honte, en un destin dominé.
La mise en place de stratégies de résistance qui apparaît chez la plupart d’entre nous lorsque la maladie se présente est très souvent observée. Cependant, il faut distinguer résistance et résilience, même si la résistance va faire partie de la résilience. La résilience sera une étape supplémentaire à la résistance. Après la maladie, une vie nouvelle est susceptible d’apparaître et de se développer. C’est la vie qui se réinvente et qui surgit après la mort psychique. La résilience guérit et en même temps aguerrit, elle rend plus fort. Elle donne la force d’aimer. (Desmet et Pourtois, 2004).
2.1.7 Pratique infirmière et résilience
Le développement de la résilience passe, pour les professionnels, par un autre regard sur la réalité, en vue d’un meilleur usage des stratégies d’intervention. Ce regard cherche, au-delà des symptômes et des comportements, à détecter et à mobiliser les ressources des personnes, de leur entourage, de la communauté. Il conduit à abandonner tout déterminisme fataliste, toute idée de reproduction transgénérationnelle automatique et tout perfectionnisme, afin que la personne et la famille cherchent, dégagent et se construisent elles-mêmes un chemin de vie. Ce changement dans la façon de voir les autres implique, pour les professionnels comme pour l’entourage, une remise en question de bien des « évidences » et de certaines attitudes personnelles, corporatistes, culturelles, institutionnelles (Manciaux, 2001).
Les changements de routine déclenchés par la maladie chronique ne sont pas toujours pris en compte de manière adéquate, ce qui peut entraîner des difficultés dans les soins et le contrôle de la maladie, ainsi que du stress et de la souffrance, non seulement pour le patient, mais aussi pour les parents les plus proches. Certaines personnes parviennent à surmonter les difficultés, à suivre le traitement et à faire face aux adversités, faisant ainsi preuve de résilience.
2.2 Cadre théorique
Une meilleure compréhension de la contribution de ces facteurs personnels et contextuels pourrait offrir aux infirmières des connaissances leur permettant de promouvoir la résilience face à l’adversité et ainsi d’améliorer la santé des personnes (Ahern, 2006). Ces variables sont des facteurs sur lesquels les infirmières pourraient intervenir s’ils s’avéraient des prédicteurs significatifs de la résilience. Un modèle conceptuel en soins infirmiers, tel le modèle McGill, sert de guide au développement des connaissances propres à la discipline infirmière (Fawcett, 1991; Kravitz & Frey, 1989). De l’avis de Gottlieb et Ezer (1997), le modèle McGill est à la fois une philosophie de soins et une perspective pour guider la pratique et la recherche infirmière. La particularité de ce modèle est qu’il met l’accent sur les forces inhérentes aux familles plutôt que sur leurs déficits (Gottlieb & Feeley, 2007). Il s’arrime ainsi très bien à l’exploration du processus de la résilience individuelle ou familiale ; une perspective positive de l’expérience des personnes et familles aux prises avec les MC. Le modèle McGill en soins infirmiers repose, entre autres, sur les postulats suivants : les individus, les familles et la communauté aspirent à une meilleure santé et sont motivés à y parvenir ; la santé est un phénomène familial ; et, les soins infirmiers sont une ressource de santé primaire pour les familles et la communauté (Kravitz & Frey, 1989). Cette conception infirmière est centrée sur la réponse aux situations de santé qu’Allen appelle Situation-Responsive Nursing. Récemment, l’évolution de cette appellation fait en sorte qu’elle s’est intégrée à une vision plus large de la relation infirmière-patient et qu’elle est maintenant renommée par Gottlieb et Feeley (2007) partenariat de collaboration. Le modèle McGill compte quatre concepts suivants : la santé, la famille, la collaboration et l’apprentissage (Gottlieb & Rowat, 1987 ; Kravitz & Frey, 1989 ; Malo et al., 1998). Ces concepts centraux (santé et famille) font l’objet d’une brève présentation dans les paragraphes qui suivent.
La santé, concept au centre même du modèle McGill en soins infirmiers, de même que la maladie sont considérées comme des entités distinctes qui coexistent (Allen, 1983). « Être en santé dans la maladie » s’avère donc possible (Allen & Warner, 2002). La santé est par définition une façon d’être, de vivre et de se développer (Allen & Warner, 2002) tout comme un processus d’apprentissage dynamique qui comporte deux dimensions importantes : le coping et le développement de la famille ainsi que de ses membres (Kravitz & Frey, 1989).
La famille demeure la principale cible des soins infirmiers car c’est au sein du système familial que la santé et ses comportements favorables y sont principalement appris (Allen & Warner, 2002 ; Gottlieb & Rowat, 1987 ; Kravitz & Frey, 1989). Dans une perspective systémique, l’individu et la famille sont considérés comme des systèmes ouverts en interaction constante l’un avec l’autre et avec d’autres systèmes dans leur environnement (Allen & Warner, 2002 ; Gottlieb & Rowat, 1987). La famille est avant tout active, capable de résoudre ses problèmes, apte à apprendre de ses expériences antérieures et à s’appuyer sur ces dernières pour atteindre ses buts (Gottlieb & Rowat, 1987). Le modèle McGill en soins infirmiers est, en quelque sorte, porté par la croyance voulant que les solutions nécessaires à la résolution de problèmes ou au dénouement de situations difficiles résident au sein même de la famille et de ses membres (Gottlieb & Rowat, 1987).
Cette croyance est fortement partagée par l’investigateur de la présente recherche. Tous possèdent les forces, le potentiel et les ressources. De fait, dans ce nouveau contexte, l’infirmière a pris une place essentielle dans l’accompagnement de l’apprentissage de la santé auprès des familles. La cible des soins infirmiers est étendue à la famille qui peut apprendre de ses propres expériences de santé. Le processus d’apprentissage se situe alors au centre de l’action, avec comme objectifs principaux;: explorer, négocier, collaborer, coordonner les buts fixés en partenariat entre la personne soignée, sa famille et le soignant.
La personne et son entourage sont compris comme des individus, des familles et des communautés qui aspirent à un meilleur niveau de santé. Parce que les solutions aux problèmes de santé résident dans l’unité familiale, l’infirmière va s’intéresser à l’individu dans son contexte familial ou à la famille par rapport à l’individu. La personne est un partenaire actif qui collabore et trouve des solutions à ses problèmes;; ces solutions proviennent donc de la personne ou du groupe familial, et non de l’infirmière. La participation active de chacun des membres du système est un postulat de la mise en œuvre du modèle McGill. En effet, si la personne existe en tant que sujet, ce qui est dominant c’est qu’elle est perçue à travers le filtre familial;: parent, ami, voisin. La famille est donc définie au sens large et c’est l’entité familiale qui sera concertée lors de situations de soins.
2.3 Récensions des écrits
Au Royaume-Uni, Heyworth et ses collaborateurs (2009) ont publié une étude visant à connaître l’impact de maladies chroniques sur la qualité de vie. Utilisant un questionnaire postal envoyé à la clientèle de deux cliniques de médecine familiale, ils ont recruté 5169 participants âgés de plus de 16 ans pour participer à l’étude. Ils ont utilisé l ’Euro-Qol, une échelle de qualité de vie européenne, portant sur cinq dimensions : la mobilité, l’intérêt porté à sa propre santé, les activités usuelles, la douleur et l’inconfort ainsi que l’anxiété et la dépression. Les maladies chroniques étaient documentées à l’aide des dossiers médicaux. Les résultats démontrent encore une fois une corrélation inverse entre la QV et le nombre de maladies chroniques. La gravité des maladies n’a toutefois pas été prise en compte et seulement 46,3 % des personnes sollicitées ont répondu aux questionnaires, ce qui en limite la généralisation. Les personnes atteintes de multi morbidité expriment une altération de leur qualité de vie (Duguay et al., 2012).
Eut égard donc de la situation éprouvante des maladies chroniques sur la qualité de vie des patients atteints et la difficulté d’une prise en charge globale il a paru donc efficient de penser de nouveaux concepts pour l’amélioration des conditions de vie notamment une approche résiliente.
Une étude menée donc au Brésil sur;: L'ÉVALUATION DE LA RÉSILIENCE DES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES ET DE LEURS SOIGNANTS
Objectif : évaluer la résilience des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs soignants. Méthode : il s'agit d'une étude quantitative, descriptive et transversale, menée auprès de 98 patients et membres de leur famille, au domicile du participant. La collecte des données s'est faite par le biais d'entretiens semi-structurés et de l'échelle de résilience de Young. Des statistiques descriptives ont été réalisées, ainsi que le chi carré et le test exact de Fisher en adoptant la valeur p <0,05 comme significative. Les résultats sont présentés dans des tableaux. Résultats : sur les 98 participants, 26,53 % sont des soignants et 73,47 % des patients. Le score moyen sur l'échelle de résilience était de 143,90 points (±15,98) et la médiane de 145,00 points, avec un score minimum de 53 et un maximum de 171, en considérant le score maximum possible sur l'échelle de 175 points. Conclusion : prévalence des aidants âgés de moins de 60 ans, de sexe féminin et ayant une éducation primaire incomplète. Les patients ont présenté des scores minimums plus élevés sur l'échelle de résilience, se révélant plus résilients que leurs soignants. Des critères : Maladie chronique ; résilience psychologique ; soins infirmiers ; soignants ; relations familiales ; promotion de la santé.
Ceci montre à suffisance qu’il importe toutefois d’être prudent dans l’interprétation des résultats, car chiffrer la résilience, c’est le danger d’interpréter hâtivement les résultats, de stigmatiser plutôt que d’aider à renforcer la résilience.
C’est peut-être dans ce sillage qu’une étude a été menée sur LE TRAUMATISME PSYCHIQUE ET LA RÉSILIENCE CHEZ LES HOMMES DIABÉTIQUES AMPUTÉS ET HOSPITALISÉS par FERDJALLAH Yamina pour mieux évaluer et décrire l’effet traumatique de l’amputation sur le vécu psychologique des hommes diabétiques hospitalisés, en décelant un avant et un après, ainsi, de comprendre sur quel support ils se sont étayés, pour surmonter et faire face à leur situation, en mettant l’accent sur les ressources de personnalité internes et l’existence des relations affectives de leur entourage, pour voir leur capacité à représenter l’expérience subie et à la dépasser. Appuyés sur l’approche cognitivo- comportementale (TCC). Dès lors, nous constatons que chez nos sujets de recherche la qualité de leur résilience dépend de l’impact du traumatisme, de l’amputation sur leur vécu psychologique. En effet, l’impact du trauma est important chez les sujets présentant des capacités de résilience faibles et l’impact du traumatisme est moins important chez les sujets présentant de bonnes capacités de résilience. On conclut cette discussion en indiquant la relation existante entre l’intensité des symptômes traumatiques et le type ou la nature du caractère résilient chez nos sujets. Nous constatons des symptômes sévères chez les sujets peu résilients et des symptômes légers chez les sujets résilients (Ferdjallah et al., 2019).
Une étude intitulée « La relation entre la résilience et le comportement sain chez les diabétiques » a été effectuée à Ouargla auprès d’un échantillon qui se compose de 205 personnes diabétiques (70 hommes et 135 femmes), qui sont âgés entre 20 ans et 55 ans, dont l’objectif est de détecter la corrélation entre la résilience et le comportement sain chez ces diabétiques selon la durée de la maladie et le sexe. Pour la récolte des données ils se sont appuyés sur l’entretien clinique semi-directif, l’échelle de résilience de Mkhimer, et une autre échelle qui mesure le comportement sain. Les résultats de cette étude ont révélé que la résilience permet aux diabétiques de reconnaitre la maladie d’une manière positive et non comme un facteur de stress explosif, démontrant aussi leur capacité à s’adapter d’une manière positive, ainsi que la durée de la maladie rend également le patient capable de compter sur soi.
Cette étude prouve qu’une éducation thérapeutique fondée sur la résilience auprès des personnes vivant avec des MC serait bénéfique non seulement pour une meilleure observance thérapeutique mais aussi et surtout pour une vie adaptée et épanouie en dépit de la situation de la maladie. Ainsi, face aux traumatismes, certains s’en tirent mieux que d’autres. Ils vivent, rient, aiment, travaillent, créent, alors que les épreuves qu’ils ont traversées auraient logiquement dû les terrasser. Cette énigme s’appelle la « résilience ». La résilience est caractérisée par la capacité à surmonter les épreuves de la vie, est un comportement adaptatif positif. L’individu résilient trouve des ressources pour tenir le coup. Parmi les nombreuses pistes et suggestions susceptibles de favoriser la résilience, il est possible de noter le rôle du lien social et de la confiance en soi, en l’autre, des différentes expériences de vie, tels que savoir donner sens à une chose insensée, savoir positiver une situation stressante, savoir prendre des risques et savoir faire face. Nous nous proposons au travers notre étude sur «; les déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de Maladie chronique;» d’identifier les ressources résilientes que sont dotées les personnes souffrantes de la maladie chronique.
Chapitre 3: Approche méthodologique
Ce chapitre ressort les moyens utilisés pour mener cette recherche. Ainsi, y sont développées, le lieu de l’étude, les limites de l’étude et la méthodologie utilisée plus précisément le type de l’étude, la méthode de recherche, la population enquêtée, la durée de l’enquête, la technique d’échantillonnage, l’outil de collecte des données et les précautions éthiques de l’étude, ainsi que la communication des résultats.
3.1 Présentation du lieu de l’étude
Notre étude s’est déroulée dans les hôpitaux de la ville de Mbouda à savoir;:
L’hôpital de district de MBOUDA (HD Mbouda), L’hôpital AD-LUCEM de MBOUDA (HA-D Mbouda), L’hôpital Protestant de Montchio de MBOUDA (HP Mbouda).
Nous présentons dans les prochaines lignes un aperçu général nous donnant une vue d’ensemble de ces lieux.
3.1.1 L’hôpital de district de MBOUDA
Crée en 1960 comme étant un dispensaire, l’HD Mbouda est une institution publique à caractère social;; Il est situé dans la Région de l`Ouest, dans le département de Bamboutos, au quartier Bamessingué, c’est une formation sanitaire de première référence de soins préventifs, curatifs,; au bord de la route secondaire reliant la ville de Mbouda et l`arrondissement de GALIM, dans l`aire de santé de Mbouda- Nord du District de Santé de Mbouda et couvre deux arrondissements sur les quatre que compte le département des Bamboutos à savoir l`arrondissement de Mbouda et l`arrondissement de Babadjou. L’HDM mène les activités curatives, préventives, promotionnelles et de réhabilitation à travers ses différents services administratifs et techniques. Sa superficie est de 3 hectares non clôturés.
3.1.1.1 Ressources infrastructurelles
L’hôpital de district de Mbouda est constitué de 9 bâtiments, ayant une entrée principale et 2 entrées secondaires (morgue et service de santé de district). L’HD de Mbouda regorge plusieurs services en son sein tels que;:
Le bâtiment B1 abrite;:
- La direction de l’HDM,
- Le Bloc opératoire
- La Pharmacie (caisse).
Le bâtiment B2 comprend;:
- Le service d’Accueil et orientation
- L’Économat/Cession
- Le bureau de consultation d’anesthésie
- Deux bureaux de consultation médicale.
Dans le bâtiment B3 sont logés;:
- Le service de Planification Familial
- L’Unité de prise en charge (UPEC) des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA
- Le service de counseling VIH/SIDA
- Le Centre de Traitement de la Tuberculose (CDTT) de Mbouda
- Un bureau de consultation médicale
- Le service d’Odontostomatologie
- Le bureau du Comptable matières
- Le service de Kinésithérapie
- Le service d’Imagerie Médicale (Radiologie et Échographie).
Dans le bâtiment B4 sont aménagés;:
- Le service de Chirurgie
- La pharmacie (point de distribution)
- Le bureau du médecin
- Le service d’Ophtalmologie.
Le bâtiment B5 abrite le service de la Maternité Le bâtiment B6 comprend;:
- Le service de Pédiatrie
- Le bureau du surveillant Général
- La Pharmacie (Magasin).
- Dans le bâtiment B7 est logé le service de Laboratoire d’Analyses Médicales.
Le bâtiment B8 abrite;:
- Le service de Médecine,
- Les salles d’hospitalisation en Haut Standing,
- La salle de réunion,
- La salle d’isolement,
- La salle de coloration des crachats.
- Un bureau de consultation en santé mentale.
- Le bâtiment B9 où est aménagée la Morgue.
Enfin le bâtiment B10 qui abrite le pavillon mère et enfants
- Le service de consultation prénatale
- Le service de vaccination.
3.1.1.2 Ressources humaines
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tableau I ;: Répartition du personnel de l'hôpital de district de Mbouda
3.1.1.3 Ressources matérielles
L’HD Mbouda dispose;:
- D’un château d’eau d’une capacité de 40 m,
- D’une ambulance (vétuste);;
- D’un groupe électrogène;;
- Du matérielle médico-chirurgical;;
- D’équipements pour les analyses médicales;;
- D’un appareil pour la radiographie conventionnelle et un échographe.
3.1.1.4 Activités
L’HD Mbouda mène les activités curatives, préventives, promotionnelles et de réhabilitation à travers ses différents services administratifs et techniques que sont l’Accueil et Urgences, la Pédiatrie, la médecine, la Maternité, la Chirurgie, le Bloc opératoire, le Laboratoire, l’Imagerie médicale (Radiographie et Échographie), la Consultation Prénatale, la Vaccination, le Planning Familiale et la Morgue. Il abrite en plus l’UPEC des PVVIH/SIDA et le CDTT.
3.1.2 L’hôpital AD-LUCEM de Mbouda
Crée en 1959 comme étant un dispensaire, l’HA-D Mbouda est une institution privée de type sanitaire;; Il est situé dans la Région de l`Ouest, dans le département de Bamboutos, au quartier Montchio, c’est une formation sanitaire offrant des soins préventifs, curatifs, a environs 500m de la place des fêtes de la ville de Mbouda, dans l`aire de santé de Mbouda- Nord du District de Santé de Mbouda. L’HA-D Mbouda mène les activités curatives, préventives, promotionnelles et de réhabilitation à travers ses différents services administratifs et techniques. Sa superficie est de 3,2 hectares clôturés.
3.1.2.1 Ressources infrastructurelles
L’HA-D Mbouda est constitué de 12 bâtiments, ayant une entrée principale (avec une guerite). L’HA-D Mbouda regorge plusieurs services en son sein tels que;:
Le 1er bâtiment abrite;:
- La caisse,
- La pharmacie,
- Les toilettes.
- La réserve,
- La radiologie.
Le 2e bâtiment comprend;:
- Un amphithéâtre,
- Les bureaux de consultations médicales,
- L’accueil,
- Le bureau de recouvrement,
- Le laboratoire,
- La salle de vaccination.
- Deux bureaux de consultation médicale.
Dans le 3e bâtiment sont logés;:
- Le bureau du surveillant général,
- Le bureau du médecin dentiste,
- L’ancien service de pédiatrie,
- Le service de médecine.
Dans le 4e bâtiment sont aménagés;:
- Le service de Chirurgie hospitalisation,
- Le bloc opératoire,
- La réanimation,
- La petite chirurgie,
- La kinésithérapie.
Le 5e bâtiment abrite;:
- La salle d’accouchement,
- La néonatalogie,
- Le planning familial,
- Le bureau du gynécologue,
- Le bureau de consultation prénatale.
Le 6e bâtiment comprend;la direction Dans le 7e bâtiment est logé;:
- La morgue,
- La chapelle.
- Le 8e bâtiment abrite;les résidences des Médecins.
- Le 9e bâtiment où est aménagée une autre résidence de médecin.
- Le 10e bâtiment loge en son sein la buanderie.
- Enfin le bâtiment 11e abrite la résidence du personnel en pré-emploi.
3.1.2.2 Ressources humaines
Tableau II : Répartition du personnel de l'hôpital AD-Lucem de Mbouda
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.1.2.3 Ressources matérielles
L’HA-D Mbouda dispose;:
- De plusieurs châteaux d’eau;;
- D’une ambulance;;
- D’un groupe électrogène;;
- Du matérielle médico-chirurgical;;
- D’équipements pour les analyses médicales;;
- D’un appareil pour la radiographie conventionnelle et un échographe.
3.1.2.4 Activités
L’HA-D Mbouda mène les activités curatives, préventives, promotionnelles et de réhabilitation à travers ses différents services administratifs et techniques que sont l’Accueil et Urgences, la Pédiatrie, la médecine, la gynéco-obstétrique, la Chirurgie, le Bloc opératoire, le Laboratoire, l’Imagerie médicale (Radiographie conventionnelle et Échographie), la Consultation Prénatale, la Vaccination, le Planning Familiale et la Morgue. Il abrite en plus l’UPEC des PVVIH/SIDA.
3.1.3 L’hôpital Protestant de Montchio de Mbouda
Crée en 1990, l’HP Mbouda est une institution privée à caractère sanitaire;; Il est situé dans la Région de l`Ouest, dans le département de Bamboutos, au quartier …, c’est une formation sanitaire de qui offre des soins préventifs, curatifs, au bord de la route secondaire reliant la ville de Mbouda et à la ville de Bafoussam. L’HP Mbouda mène aussi les activités curatives, préventives, promotionnelles et de réhabilitation à travers ses différents services administratifs et techniques. Sa superficie est de 1 hectares et demi non clôturée.
3.1.3.1 Ressources infrastructurelles
L’hôpital Protestant de Montchio de Mbouda est constitué de 7 bâtiments, ayant une entrée principale et 1 entrée secondaire (buanderie). L’HP Mbouda regorge plusieurs services en son sein;:
Le 1e bâtiment abrite;:
- L’accueil,
- Les bureaux de consultations médicales,
- La pharmacie (caisse),
- Le laboratoire d’analyse médicale,
- Le bureau de consultation prénatale,
- L’Économat,
- La salle d’hospitalisation des soins intensifs.
Le 2e bâtiment comprend;:
- La salle d’accouchement,
- La salle de réunion,
- La réserve,
- La chirurgie,
- La médecine mixte,
- La pédiatrie,
- Le bloc opératoire,
- La stomatologie,
- L’aumônerie.
Dans le 3e bâtiment sont logés;:
- Le service de kinésithérapie,
- Le service d’ophtalmologie.
Dans le 4e bâtiment sont aménagés;:
- La suite d’hospitalisation,
- Le service comptable,
- Le magasin de matériel d’entretien.
Le 5e bâtiment abrite en son sein;:
- La radiologie conventionnelle,
- La buanderie.
Le 6e bâtiment comprend;:
- La morgue,
- Les toilettes.
Enfin le 7e bâtiment abrite la résidence des médecins.
3.1.3.2 Ressources humaines
Tableau III : Répartition du personnel de l'hôpital protestant de Montchio
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.1.3.3 Ressources matérielles
L’HP Mbouda dispose;:
- D’un groupe électrogène;;
- Du matérielle médico-chirurgical;;
- D’équipements pour les analyses médicales;;
- D’un appareil pour la radiographie conventionnelle et un échographe.
3.1.3.4 Activités
L’HP Mbouda effectue des activités curatives, préventives, promotionnelles et de réhabilitation via différents services administratifs et techniques entre autres;; Accueil et Urgences, la Pédiatrie, la Médecine, la Chirurgie, la Gynécologie et obstétrique, le Bloc opératoire, le Laboratoire, l’Imagerie médicale (Radiologie conventionnelle et Échographie), la Consultation Prénatale, la Vaccination, le Planning Familial, la Stomatologie, l’Ophtalmologie et la Morgue.
3.2 Justification du choix du lieu de l’étude
Ces lieux ont été sélectionnés pour des raisons suivantes;:
Tout d’abord ces différents hôpitaux sont dotés d’un plateau technique conséquent à nul autre pareil dans toute la zone d’étude, faisant ainsi une brève représentation de toute la population environnante de par la fréquentation de ses usagers.
Ensuite nous avons l’avantage de leurs situation géographique plus ou moins à proximité de notre lieu de formation.
Pour finir ces hôpitaux furent le fief de tous nos stages hospitaliers durant nos années de formation.
3.3 Méthodologie
3.3.1 Type de recherche
Notre recherche est de type qualitatif descriptif. Ce type de recherche permet de cerner les phénomènes sur le terrain, de les analyser et de pouvoir les expliquer en s’appuyant sur des raisonnements inductifs Nkoum (2010, p49) .
3.3.2 Méthode de recherche
La méthode clinique est celle qui a été retenue dans cette recherche. Elle nous a semblée celle qui sied mieux à notre étude car elle permet de recueillir un discours singulier et son « but est surtout de participer avec l’autre, au travail sur le sens de son projet et de son cheminement » (Nkoum, 2005, p59). Six de nos participants ont été enquêtés à l’hôpital pendant leur hospitalisation et quatre autres par appel téléphonique grâce aux coordonnés pris dans les dossiers médicaux.;
3.3.3 Populations d’enquête
Maurice ANGERS (1997) définit population d’enquête comme étant l’ensemble d’éléments d’une ou plusieurs caractéristiques en commun qui les distinguent d’autres éléments sur lesquels porte l’investigation. Dans le cadre de cette étude, la population cible a été constituée de toutes personnes adultes vivant avec au moins une maladie chronique fréquentant ces hôpitaux.
3.3.4 Critère du choix des répondants
Pour participer à cette étude, quelques critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis.
3.3.4.1 Critères d’inclusion
Toute personne résiliente vivant avec au moins une maladie chronique
3.3.4.2 Critères d’exclusion;
Ont été exclus de cette étude tous les participants ayant refusés de signer le formulaire de consentement éclairé ou dont l’état de conscience ne permettait pas un entretien.
3.3.5 Technique d’échantillonnage
La technique d’échantillonnage retenu dans le cadre de cette étude est celui de convenance.
3.3.6 Taille de l’échantillon
La taille de notre échantillon a été déterminée par l’atteinte du niveau de saturation. On parle de saturation lorsque les données recueillies et leur analyse ne fournissent plus les explications nouvelles sur le phénomène à l’étude.
3.3.7 Collecte des données
3.3.7.1 Outils de collecte des données
Pour obtenir les informations auprès de nos enquêtés, nous nous sommes servis de deux outils à savoir une échelle de résilience et un guide d’entretien. L’échelle de résilience de Wagnild et Young (1993) a été au préalable utilisé pour la sélection des personnes résilientes vivant avec des maladies chroniques ensuite il leur a été soumis un guide d’entretien assorti des axes qui pour déterminer les ressources résilientes chez celles-ci. Chaque participant à cette étude a eu droit à un seul entretien pendant une durée de 45 minutes au plus.
Notre investigation étant de type qualitatif et la méthode utilisée clinique, le guide d’entretien est un des outils de référence dans cette méthode. Cet outil est justifié du fait que cette étude soit l’une des premières dans le contexte Camerounais sur le sujet, d’où il parait adéquat de recueillir leurs propos lors d’un entretien en vue de faire émerger des catégories.
- Durée de l’étude
Cette investigation s’est étalée sur sept mois selon le chronogramme académique, soit allant de Novembre 2019 à Juin 2020.
- Période de la collecte
Notre enquête s’est déroulée sur une période de deux semaines du 05 au 19;Mai 2020.
3.3.7.2 Technique de collecte des données
Nous avons utilisé un guide d’entretien suivant un entretien semi directif face à face pour collecter les données. Pour Lekani (2018) Cette une technique qualitative de recueil d’information permet de centrer le discours sur des personnes interrogées autour des thèmes définis préalablement et consignés dans un guide d’entretien. Il n’enferme pas le discours de l’interviewé dans les questions prédéfinies. Il lui laisse la possibilité de développer et d’orienter son propos, les différents thèmes devant être intégrés dans le fil du discours de l’interviewé. L’entretien semi-directif permet de recueillir des informations de différents types : des faits et des vérifications de faits, des opinions et des points de vue, des analyses, des propositions, des réactions aux premières hypothèses et conclusions des évaluateurs. C’est une technique qui peut donc être utilisée à tout stade du processus d’évaluation : pour établir une théorie sur le programme évalué, identifier les problèmes, besoins et améliorations nécessaires.
3.3.8 Analyse des données
Les données collectées ont été traitées par analyse de contenu après leur transcription.
3.3.9 Considérations éthiques
Dans la condition inextricable où le consentement des participants dans le strict respect de la clairance éthique devait être obtenue, une demande d’autorisation d’enquête a été adressée aux différents responsables de ces structures hospitalières. À chacun des participants a été remis une notice d’information qui présentera les objectifs du projet ainsi que les différentes mesures prises pour assurer la confidentialité des données recueillies. Ces mesures sont entre autres;: la conservation des données sous forme numérique accessible uniquement par l’investigateur et de son encadreur, attribution des patronymes pour protéger leur identité, la liberté de se retirer à n’importe quel instant de l’étude. À cette notice d’information, il sera adjoint un formulaire de consentement éclairé pour valider l’adhésion des individus à l’étude.
3.3.10 Limites de l’étude
Aucune conception humaine n’étant pourvu de perfection, encore dans les premiers pas dans la recherche, il comporte inévitablement certaines limites, notamment;:
- Du fait que ces études n’ont pas assez été développées dans notre pays donc les ressources documentaires paraissent inexistantes.
- Les études seront faites uniquement dans la ville de Mbouda ce qui nous ne permettrons pas d’assurer une plus grande objectivité.
3.3.11 Communication des résultats
Les résultats de cette étude seront communiqués publiquement lors de la soutenance. Les critiques, remarques et suggestions du jury nous permettrons de faire des corrections nécessaires et objectives avant le dépôt du document final à la bibliothèque de notre institution et aux différentes structures hospitalières puis faire l’objet d’une possible publication.
Chapitre 4;: Présentation et analyse des résultats
Cette partie est consacrée à la présentation et à l’analyse des résultats de la recherche. Elle présente dans un premier temps les données relatives aux caractéristiques sociodémographiques des participants de cette étude. Dans un second temps, y ressort la structuration des ressources résilientes de ces personnes.
4.1 Caractéristiques sociodémographiques des participants
Nous avons mené notre étude auprès de dix personnes, dans le but de respecter l’anonymat et la confidentialité des participantes, leurs noms sont remplacés par des prénoms arbitraires choisit au hasard. Le tableau ci-dessous donne une présentation générale de ceux-ci.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tableau IV : Caractéristiques sociodémographiques
 la lecture de ce tableau, la tranche d’âge des enquêtés varie de 19 à 72 ans;; ces personnes sont suffisamment adultes et affectées d’une ou plusieurs maladie(s) chronique(s). Il s’agit des personnes ayant une expérience assez longue dans l’épreuve de la maladie, donc ils sont à même de répondre de façon claire à toutes les questions qui leur seront posées. Ainsi, les réponses qu’elles donnent aux questions que nous leur posons sont bien réfléchies et doivent être prises en considération.
Concernant le sexe, nous notons une prédominance de sexe féminin soit 06 sur 10. Le niveau d’étude quant à lui montre que trois sur dix se sont limitées au primaire, cinq ont atteint le secondaire et deux sur dix ont un niveau supérieur. En dehors de celles ayant un niveau primaire qui auront besoin d’amples explications pour comprendre certaines appréhensions, les sept autres ont une aptitude à mieux comprendre leur situation.
Pour ce qui est du nombre d’enfants et du statut matrimoniale, nous constatons que pour les enquêtés, la majorité est mariée, deux par contre sont célibataires et une veuve;; mais la plupart ont au moins deux enfants et au plus 10 enfants;à l’exception des deux célibataires qui n’ont aucun enfant à charge.
À propos de la profession de nos répondants il en ressort que la plus grande partie exerce dans le secteur informel soit 08/10 des personnes interrogées. Ce qui pourrait être un facteur déterminant de la difficulté dans l’autogestion des frais de prestations de soin. La religion enfin pour sa part est une affaire de tous car six sont catholiques, deux protestants et deux font dans les églises réveillées. Enjeu majeur pour mieux endurer l’épreuve traumatisante.
Dans la rubrique suivante, nous décrirons les ressources personnelles et contextuelles de résilience des personnes souffrantes de maladie chronique.
4.2 Les ressources personnelles dans le processus de résilience
Il en ressort des propos de nos participants que beaucoup n’ont pas une idée exacte de la cause responsable de leur état actuel c’est le cas de Roger qui déclare;« ;je ne fume pas, je ne buvais pas trop, je ne comprends même pas l’origine de la maladie;» d’autres par contre ont une idée assez subjective de la maladie comme Thérèse qui pense qu’ « ;un animal est monté sur mon orteil et depuis on a dit que j’ai le rhumatisme;» cet état de fait pourrait être un facteur entravant du processus de l’acquiescement de la maladie . Pour la plupart l’épreuve de la maladie est une affaire de longue date, Clémentine dit souffrir «;depuis la grande enfance, quand j’étais née à 3 ans mes jambes étaient archées;[…] et je souffre depuis » mais l’on ne s’habitue pas toujours à son état, peu importe le nombre d’années qu’on subit le traumatisme car elle bouleverse considérablement la vie sociale, professionnelle ou familiale du concerné.;Roger déclare :
- Ma vie a changée, je ne vis plus normalement, je vais d’hôpitaux en hôpitaux. Manger normalement, se déplacer seule devient pénible car j’ai besoin très souvent d’aide. La perte de poids excessive s’en suis, je ne travaille plus si oui à balmayo depuis deux mois je vivote.;»
De ceci naissent des difficultés dans le traitement, ces difficultés souvent d’ordre physiologiques pour certains comme le pense Patrick; «;[…] j’ai la faiblesse sexuelle peut-être c’est aussi ça car c’est depuis le début du traitement;» mais plus encore dans l’observance thérapeutique pour d’autres vu que la satisfaction n’est pas immédiate ou imminente, elle est dans la plus part du temps lente à venir d’où le possible découragement comme le souligne Esther;: «;je n’aimais pas voir venir le personnel soignant;». D’autre par contre trouve ces difficultés dans l’utilisation des produits thérapeutiques et font l’apanage d’une quête d’un produit plus efficace que le précédent c’est le cas de Clémentine «;j’essaie toutes les pommades prescrites, ça finit un peu;».
Face à toutes les répercussions de la maladie et les difficultés qu’il en suit dans le traitement, la personne finit par trouver assez de ressources pour accepter l’adversité et poursuivre son développement voire modifier son projet de vie de façon efficiente. Pour ce faire la prière et l’hyper optimisme deviennent des voies d’issues pour certain c’est le cas de Dorine «;tel est la volonté de Dieu je prie pour ma situation ça ira;», Arthur lui dit «;j’ai espoir qu’un jour ou l’autre je vais retrouver la santé;», la confiance en soi pour des tâches de base, l’endurcissement par des différentes expériences de vie, tels que savoir donner sens à une chose insensée, savoir positiver une situation stressante, savoir prendre des risques et savoir faire face. Seule dans ce processus, la personne est vouée à un échec certain car personne ne peut vivre en autarcie absolue, dans l’adversité l’environnement devient le meilleur allier.
4.3 Les ressources contextuelles dans le processus de résilience
L’annonce de la maladie ou du handicap est toujours un traumatisme pour l’individu et sa famille. Son contexte et la manière dont celle-ci est formulée scellent, dans les esprits, un instant à partir duquel la vie prend un nouveau tournant pour Calvin c’est;:
- Grâce à l’équipe médicale, leur explication pour gérer à domicile ma maladie j’ai facilement accepté de vivre permanent avec cette maladie;»
L’environnement d’un individu contribue en grande partie soit à l’amélioration de la santé d’un individu soit à la détérioration de celle-ci. Dans l’épreuve de la maladie, elle conserve toujours la même connotation car celui-ci étant facteur de guérison ou d’aggravation. Au vu des difficultés économiques engendrées par la maladie chronique, beaucoup ne parviennent pas à couvrir leur soin et la famille devient le principal soutien comme le précise Esther «;tous les membres de ma famille contribuent à mes soins;». Clémentine quant à elle déclare;:
- Quand je souffre la famille m’aide et quand ça passe un peu ils ne sont plus là […] ils sont surchargés et ils n’ont pas trop de temps pour moi donc on essaie de se suffire mon mari et moi malgré aussi ça part de santé titubante depuis 10 ans;»
Le soutien financier par contre à lui seule ne saurait contenter. Malgré que ce-dernier reste un pilier fondamental dans l’accompagnement, raison pour laquelle Arthur pensent qu’ :
- Ils se comportent tant bien que mal, ce n’est pas facile de dépendre des gens complètement, passer le temps à demander de l’aide vraiment ce n’est pas facile;».
Outre l’environnement, le personnel soignant qui accompagne dans l’épreuve influe aussi grandement la courbe de la charge de la maladie sur l’individu dans l’accompagne psychologique de celui-ci raison pour laquelle Esther déclare; «;la patience des soignants joue beaucoup de rôle très important dans le rétablissement des malades;», contrairement à Roger qui dit;:
- Je trouve qu’en ville à Yaoundé, les soignants sont seulement là comme ça, beaucoup plus là pour l’argent. Après mon opération j’avais des douleurs qu’ils ne s’intéressaient pas à ça. Je ne sais pas comment qualifier ce comportement, ce n’est pas normal;! C’est pour ça que je suis ici au village à la recherche d’une meilleure prise en charge;»
Ceci montre à quel point les relations de soutien d’un tiers proche ou accompagnateur semblent occuper une place particulièrement importante dans le phénomène de la résilience. La famille à travers sa cohésion, la qualité de la communication au sein de celle-ci est définitivement le premier maillon de l’assistance dans le processus dynamique et permanent de la résilience de la personne affectée par la maladie chronique.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figure 1 : Modélisation des déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique
Chapitre 5;: Synthèse et discussion des résultats
Après la présentation des résultats, nous allons procéder dans ce présent chapitre à la synthèse et discussion tout en insistant sur les déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique. Ce chapitre vise à donner sens aux résultats obtenus. Ainsi, comme dans le chapitre précédent, la synthèse et discussion sont faites en regard des objectifs que nous nous sommes fixés.
5.1 Données relatives à la présentation générale des enquêtés
L’analyse des résultats montre une prédominance féminine des enquêtés ce qui va dans le sens des études menées entre 2011 et 2014 par la Resilience Institute Europe, pour mesurer les facteurs liés à la résilience dans les entreprises en Europe, en Australie et en Asie. Où les femmes ont une probabilité deux fois plus élevée que les hommes de ressentir des symptômes de stress ou de dépression. Cette propension de la détresse a bien entendu un impact négatif sur leur résilience générale. En revanche leur empathie, leur meilleure capacité à contrôler des réactions impulsives et leur inclinaison naturelle à stimuler des émotions autour d’elles sont de grandes forces qui les rendent résilientes.
En ce qui concerne l’âge, l’ensemble de nos enquêtés sont adultes, le facteur âge pour Ribes (2006) est le temps de l’adaptation nécessaire. Adaptation à un corps qui devient de plus en plus présent, par les changements où la question du normal et du pathologique est omniprésente. L’évolution des sens, des capacités cognitives et conatives rend parfois de plus en plus complexe l’adaptation. L’âge est aussi le temps de vulnérabilité. Si la vulnérabilité physique est avérée en particulier par une moindre résistance aux infections ou la plus grande fréquence des troubles locomoteurs, il n’en est pas de même sur le plan psychologique. Pour Aldwin et ses collaborateurs (1998) «; les aînés apprennent à discerner les stratégies les plus appropriées à la spécificité des situations, gaspillant moins d’énergie en utilisant des stratégies moins nombreuses mais plus efficaces ». Deux recherches récentes, menées en Suède et en Belgique, mettent toutefois en évidence que le niveau de la résilience augmente avec l’âge.
Les résultats obtenus montrent que plus de la moitié de nos enquêtés ont des activités précaires (secteur informel). Ce qui s’arrime avec l’étude menée par Peytremann et Burnand (2009) qui ressortait une corrélation entre la précarité socioéconomique et/ou le grand âge dans les MC. La coexistence de ces deux facteurs sont des déterminants négatifs pour une résilience d’un malade chronique qui ressent le besoin de sécurité tant dans ses moyens financiers que physique qu’est le poids de l’âge.
5.2 Données relatives aux ressources personnelles dans le processus de résilience
D’un point de vue extérieur, une maladie chronique traitée biologiquement paraît stabilisée. Or du point de vue du patient il n’en est rien. Dans sa vie quotidienne, sa «;vraie vie;», il rencontre des hauts et des bas, des moments d’abattement et de désespoir, des temps de crises, des temps de paix, des temps d’espoir. La croyance en soi devient un enjeu majeur, pour porter un regard plus positif.; L’estime de soi est un des facteurs de protection en jeu dans le développement de la résilience, qui se renforce par les épreuves surmontées. Si chaque individu dispose de connaissances résilientes, la plupart d’entre nous ne les utilisent pas de manière consciente. Des études attestent que chaque individu peut construire et entrainer des aptitudes de résilience et d’autogestion à chaque moment de sa vie indépendamment de sa dotation génétique. Mais cette connaissance peut se perdre comme le montre les propos d’une participante «;Il y a des moments que je regrette, ça m’énerve tellement;».
Le facteur religion fait ressortir dans les caractères de nos enquêtés une relation avec leur capacité de résilience. Pour Cyrulnik;:;«;la croyance en Dieu est un précieux facteur de résilience;». Le recours à la religion favorise le développement des stratégies permettant d’affronter avec succès l’adversité polymorphe pouvant être chronique ou aigue, qu’on peut rencontrer à un moment ou à un autre de la vie c’est le cas pour certains «;je prie Dieu pour retrouver la santé;».
Mais une autogestion adaptée est donc la base de l’encouragement et du renforcement de la résilience. Elle pousse à atteindre une attitude spirituelle orientée vers l’avenir et optimiste qui nous soutient de manière renforcée. L’autogestion est plus profonde que la gestion de soi ou de son temps, étant donné qu’elle touche à la responsabilité et à la réalisation de soi. Un tel état d’auto-détermination et d’auto-responsabilisé renforce la résistance personnelle en termes d’agissements ce qui épouse les recherches faites sur l’importance de la résilience en contexte maladie chronique de Ferdjallah et al. (2019) et ceux menées à Ouarlga.
5.3 Données relatives aux ressources contextuelles dans le processus de résilience
L’annonce du diagnostic de la maladie chronique présente un caractère soudain, malgré parfois une longue succession d’examens. Elle sidère en créant un avant et un après. L’on n’est pas en mesure de l’intégrer immédiatement, interpréter correctement toutes les données quantitatives et le jargon médical qui les accompagnes. Le pronostic est encore plus difficile à comprendre à cause de la combinaison complexe de facteurs biologiques, comportementaux et environnementaux (Magro et Coll, 2016). La manière d’annoncer la maladie et ses implications est une des conditions déterminantes pour faciliter l’approbation d’une maladie chronique. Une annonce de mauvaise qualité par exemple, avec des termes vagues, non bienveillants, non authentiques et/ou surprotecteurs aggrave le traumatisme. Certains patients se sentiront détachés de la situation, et se placeront en spectateur de ce qui leur arrive. D’autres refuseront le diagnostic et voudront recommencer tous les examens avec d’autres praticiens.
Le diagnostic de la maladie chronique peut être un moteur motivationnel majeur de changement de comportement si l’annonce est bien faite. L’équipe de professionnels doit tout mettre en œuvre pour associer le patient à la prise de décision et l’aider à maintenir ce changement de comportement à long terme (Matheson et Coll, 2011). L’application de cette approche plaide pour l’autonomisation des choix dans le traitement individuel des patients tout en considérant les qualités humaines du professionnel à savoir l’empathie, la bienveillance, l’écoute et la disponibilité comme un de nos répondants le rappelait déjà «;La patience des soignants joue beaucoup de rôle très important dans le rétablissement des malades;» ce qui favoriserait une résilience primaire. Le personnel constitue le premier noyau environnemental de la résilience de l’individu dans le sens de prise en soin, avant sa famille
Les études faites par Seoud (2013) ont fait ressortir l’impact d’une mauvaise communication familiale ou encore des conflits entre proche aidant et le pronostic de vie des personnes âgées. Il ressort de notre étude qu’un soutien permanent de la famille encouragerait la personne à s’invertir d’avantages pour continuer son développement «;Je cède aux exigences de mes proches qui sont là pour me rappeler ce pour quoi je me bats;» à travers des aides financières en situation de crise ou de réconfort en phase d’accalmie. Cette corrélation entre la famille et la résilience des personnes se justifie par le fait qu’elle est le siège de tout développement. Par ailleurs, l’absence d’un soutien familial a également été notifiée comme constituant un facteur négatif de résilience et sombre d’avantages la personne dans une spirale infernale.
Conclusion
In fine, cette étude portant sur «;les déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de la maladie chronique;» dans les hôpitaux de la ville de Mbouda s’inscrit en tant que l’une des pionnières dans notre contexte. Il est important de rappeler qu’il était question pour nous de déterminer les ressources de résiliences chez les personnes vivant avec des maladies chroniques.
Pour s’y atteler, nous avons mené une étude qualitative de type descriptif avec comme objectif principal la détermination des ressources de résilience. Cet objectif a été opérationnalisé en ressources personnelles et contextuelles. En vue de l’atteinte de ces objectifs, nous avons effectué une collecte de données auprès de dix patients en cours d’hospitalisation dans les hôpitaux de la ville de Mbouda. Les résultats de la recherche ont montré que la bonne estime de soi (autonomie), la prière, l’hyper Optimisme, les expériences de vie, le positivisme, la bonne approche dans l’annonce de la maladie, la bonne cohésion familiale, la bonne communication, la prise en soin financier et psychologique représentent autant de ressources à l’origine de résilience des personnes souffrantes de maladie chronique.
Eut égard des répercussions des maladies chroniques sur la qualité de vie des individus. Les organismes de santé devraient travailler à offrir un environnement qui promeut un certain nombre de valeurs, contribuant ainsi à améliorer la résilience de ces personnes. Conscient des limites de ce travail, nous souhaiterions voir d’autres études similaires sur le sujet en vue de le documenter davantage et d’établir un modèle de prédiction de la résilience au sein de cette population.
Suggestions formulées au regard des problèmes
Tableau V : Suggestions formulées au regard des problèmes rencontrés
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Références Bibliographiques
Anaut, M. (2003). La résilience. Surmonter les traumatismes. Paris Nathan Université, Collection Psychologie, 128.
Anaut, M. (2006). L’école peut-elle être facteur de résilience ? Empan, 3, 30–39.
Briançon, S., Guérin, G., & Sandrin-Berthon, B. (2010). Maladies chroniques. Doc Fr Adsp, 72, 11–53. bromeling et al 2008—Google Scholar. (s.;d.). Consulté 1 juin 2020, à l’adresse https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=bromeling+et+al+2008&btnG=
Cazale, L., & Dumitru, V. (2008). Les maladies chroniques au Québec : Quelques faits marquants : Série Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Institut de la statistique du Québec.
Ces nouvelles maladies qui sévissent en Afrique. (2019, mars 13). Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/13/ces-nouvelles-maladies-qui-sevissent-en-afrique_5435616_3212.html
Corser, W., & Dontje, K. (2011). Self-management perspectives of heavily comorbid primary care adults. Professional case management, 16 (1), 6–15.
Cyrulnik, B. (2005). Le tissage de la résilience au cours des relations précoces. La résilience : le réalisme de l’espérance, 25–44. de la Santé, M. (2011). OMS. Rapport Annuel, 1.
Dubé, P. (2012). Boulad-Ayoub, Josiane. L’Abbé Grégoire et la naissance du patrimoine national, suivi de trois rapports sur le vandalisme. Québec, Les Presses de l’Université Laval,«Mercure du Nord», 2012, 99 p. ISBN 978-2-7637-9833-2. Rabaska: revue d’ethnologie de l’Amérique française, 10, 241–243.
Duguay, C., Fortin, P. M., Gallagher, P. F., O’Reilly, P. L., & Bujold, P. L. (2012). Expérience des personnes adultes atteintes de multimorbidité : Une étude phénoménologique [PhD Thesis]. Université de Sherbrooke.
Ferdjallah, Y., Hocine, L., & Benamsili, L. E. (2019). Le traumatisme psychique et la résilience chez les hommes diabétiques amputés et hospitalisés [PhD Thesis]. Université de Bejaia.
FORMARIER, M., & JOVIC, L. (2009). Les concepts en soins infirmiers. France, Mallet Conseil.
Foundation, F. (s.;d.). L’épidémie silencieuse : Les maladies non communicatives au Cameroun. Denis & Lenora Foretia Foundation | Catalyzing Africa’s Economic Transformation. Consulté 6 février 2020, à l’adresse https://www.foretiafoundation.org/news-media/publications/lepidemie-silencieuse-les-maladies-non-communicatives-au-cameroun/
Guthrie, E. (s.;d.). La psychothérapie pour des patients ayant des troubles complexes et des symptômes chroniques.
Hamel, M. B., Henderson, W. G., Khuri, S. F., & Daley, J. (2005). Surgical outcomes for patients aged 80 and older : Morbidity and mortality from major noncardiac surgery. Journal of the American Geriatrics Society, 53 (3), 424–429.
Katchunga, P., Hermans, M. P., Manwa, B., Lepira, F., Kashongwe, Z., & M’Buyamba-Kabangu, J.-R. (2010). Hypertension artérielle, insulinorésistance et maladie rénale chronique dans un groupe de diabétiques de type 2 du Sud-Kivu, RD Congo. Néphrologie & thérapeutique, 6 (6), 520–525.
Krzesinski, J.-M., & Xhignesse, P. (2007). Nouvelles directives en 2007 pour la prise en charge de l’hypertension arterielle. Revue Médicale de Liège, 62 (9), 566–574.
L’augmentation galopante des maladies chroniques en Afrique—Sanofi. (s.;d.). Consulté 7 février 2020, à l’adresse https://www.sanofi.com/about-us/your-health/the-rise-and-rise-of-chronic-diseases-in-africa
Lekoubou, A., Awah, P., Fezeu, L., Sobngwi, E., & Kengne, A. P. (2010). Hypertension, diabetes mellitus and task shifting in their management in sub-Saharan Africa. International journal of environmental research and public health, 7 (2), 353–363.
Les maladies chroniques. (s.;d.). Consulté 2 mai 2020, à l’adresse https://compare.aphp.fr/l-etude/liste-maladies.html
Les maladies chroniques bousculent la médecine. (s.;d.). Consulté 6 février 2020, à l’adresse https://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/03/20/les-maladies-chroniques-bousculent-la-medecine_5097770_1650684.html
LES MALADIES CHRONIQUES DE L’AFRIQUE AFRIKA NEWS. (2020, mars 5). Actualités en Afrique. http://news-afrik.com/les-maladies-chroniques-de-lafrique
Les maladies chroniques font payer un lourd tribut à l’Europe, selon un nouveau rapport de l’OCDE et de la Commission européenne—OCDE. (s.;d.). Consulté 6 février 2020, à l’adresse http://www.oecd.org/fr/presse/les-maladies-chroniques-font-payer-un-lourd-tribut-a-l-europe-selon-un-nouveau-rapport-de-l-ocde-et-de-la-commission-europeenne.htm
Makulo Jr, R., Nseka, M. N., Jadoul, M., Mvitu, M., Muyer, M. T., Kimenyembo, W., Mandja, M., Mapatano, M. A., Epira, F. B., & Sumaili, E. K. (2010). Albuminurie pathologique lors du dépistage du diabète en milieu semi-rural (cité de Kisantu en RD Congo). Néphrologie & thérapeutique, 6 (6), 513–519.
Manciaux, M. (2001). LA RÉSILIENCE Un regard qui fait vivre. S.E.R. https://www.cairn.info/revue-etudes-2001-10-page-321.htm
Non communicable diseases. (s.;d.). Consulté 2 mai 2020, à l’adresse https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
Organization, W. H. (2014). Activité de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale : Rapport annuel du Directeur régional pour 2013. Regional Office for the Eastern Mediterranean.
Pixl 8. (s.;d.). Maladies chroniques : Faits et chiffres. SciDev.Net Afrique Sub-Saharienne. Consulté 7 février 2020, à l’adresse http://www.scidev.net/index.cfm?originalUrl=/afrique-sub-saharienne/renforcement-des-capacites/article-de-fond/maladies-chroniques-faits-et-chiffres.html&
Quevauvilliers, J., Fingerhut, A., & Somogyi, A. (2009). Dictionnaire médical. Elsevier Masson.
Rey-Debove, J. (2006). Le Petit Robert de la langue française.
Singh, V., Chertkow, H., Lerch, J. P., Evans, A. C., Dorr, A. E., & Kabani, N. J. (2006). Spatial patterns of cortical thinning in mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Brain, 129 (11), 2885–2893.
Wagner, E. H., Austin, B. T., Davis, C., Hindmarsh, M., Schaefer, J., & Bonomi, A. (2001). Improving chronic illness care : Translating evidence into action. Health affairs, 20 (6), 64–78.
Annexes
Guide d'entretien
Renseignements généraux
1) Sexe
2) Age
3) Niveau d’étude
4) ;Profession
5) ;Religion
6) ;situation matrimoniale;
7) ;Combien d’enfant avez-vous à la charge ?
8) ;De quoi souffrez-vous;? Les ressources personnelles dans le processus de résilience
9) Depuis combien de temps souffrez-vous de cette maladie;?
10) A votre avis, à quoi est due votre maladie ?
11) Quelles sont les conséquences de celle-ci dans votre vie;?
12) Quelles sont les difficultés que vous rencontré dans le traitement ?
13) Comment surmonté vous ces difficultés;? Les ressources contextuelles dans le processus de résilience
14) Comment avez-vous été informé de votre maladie;?
15);;;; Qui prend en charge les frais de vos soins;?
16) ;La famille vous accompagne comment dans votre cheminement thérapeutique;?
17) ;Quelles sont vos attentes vis-à-vis de vos aidants ?
18) ;;Comment pouvez-vous qualifier la relation avec le personnel soignant ?
19); ;Quelles sont vos suggestions par rapport à votre accompagnement;?
Échelle de Wagnild et Young (1993)
Sur une échelle de réponse allant de « 1 » (totalement en désaccord) à « 7 » (totalement en accord) choisissez le chiffre qui correspond le mieux à votre choix sur la carte réponse…. Par exemple, si vous êtes totalement en désaccord avec le contenu d’un item, choisissez la réponse « 1 », si vous êtes neutre, choisissez « 4 », et si vous êtes fortement en accord, choisissez « 7 », etc.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Certificat éthique du projet de recherche
COMPLEXE PRIVE DE FORMATION DU PERSONNEL MEDICO SANITAIRE DE MBOUDA
FONDATION MONGA
LA NOTICE D’INFORMATION
INVITATION À PARTICIPER AU PROJET DE RECHERCHE PORTANT SUR LES DÉTERMINANTS DE LA RÉSILIENCE CHEZ LES PERSONNES SOUFFRANTES DE MALADIE CHRONIQUE
Mme, Mlle, M.
Cette recherche pour laquelle votre participation est sollicitée porte sur les déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique dans les hôpitaux de la ville de Mbouda. Elle vise à identifier les ressources mises en place par le malade et la famille pour faire face à la maladie chronique.
Objectifs
Les objectifs de ce projet de recherche sont;de ressortir les ressources contextuelles de résilience sur la qualité de vie des personnes souffrantes de MC, identifier les ressources personnelles de résilience chez celles-ci. Pour ainsi guider une nouvelle approche de soin pour une prise en charge optimale du patient chronique dans les hôpitaux de la ville de;Mbouda en particulier et du Cameroun en général. Les renseignements donnés dans cette notice d’information visent à vous aider à comprendre exactement ce qu’implique votre éventuelle participation à la recherche et à prendre une décision éclairée à ce sujet. Nous vous demandons donc de lire le formulaire de consentement attentivement et de poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin avant de prendre votre décision.
Tâche
Votre participation à ce projet de recherche consiste à remplir la fiche ci-joint portant sur les ressources mises en place par le malade et la famille pour faire face à la maladie chronique.
Risques, inconvénients, inconforts
En dehors du temps de remplissage de la fiche et du temps d’entretien qui prend une demi-heure, aucun autre inconvénient, inconfort ou risque n’est à déplorer.
Bénéfices
Le bénéfice direct que vous pourrez tirer de la participation à cette recherche est non seulement de mieux cerner le concept de résilience dans la maladie chronique mais également de contribuer à ça conceptualisation dans la prise en charge infirmière pour une prise en charge efficiente des maladies chroniques.
Confidentialité
Les données recueillies par cette étude sont soumises à l’exigence de confidentialité. Les résultats de la recherche, qui pourront être diffusés sous forme d’articles, de rapport de recherche ou de communications à des congrès scientifiques,;ne;permettront pas de vous identifier.
Les données recueillies seront conservées sur support numérique dans un disque externe sous leur forme dé nominalisée au domicile du promoteur de l’étude. Il sera attribué lors de la saisie des données dans les logiciels d’analyse un code de participant visant à assurer l’anonymat. Les données seront détruites après la publication finale du rapport de recherche et des articles ; elles ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans le présent document.
Participation volontaire
Votre participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes entièrement libre de participer ou non et de vous retirer en tout temps sans préjudice et sans avoir à fournir d’explications.
Responsable de la recherche
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour toute question concernant ce projet de recherche, vous pouvez communiquer avec Monsieur KOUECHI WONTCHEU Christian Merveille par courriel à l’adresse suivante; XX ou par téléphone au XX.
Question ou plainte concernant l’éthique de la recherche
Cette recherche est approuvée par le comité d’éthique de la recherche du Complexe Privé de Formation du Personnel Médico-Sanitaire de Mbouda. Un certificat de conformité éthique portant le numéro [no de certificat] a été émis le [date d’émission].
Pour toute question ou plainte d’ordre éthique concernant cette recherche, vous devez communiquer avec le secrétaire permanent du comité d’éthique du Complexe Privé de Formation du Personnel Médico-Sanitaire de Mbouda, par téléphone au numéro XXX XXX XXX XXX XXX ou par courrier électronique XXXXXXXXXXX.
Formulaire de consentement
COMPLEXE PRIVE DE FORMATION DU PERSONNEL MEDICO SANITAIRE DE MBOUDA FONDATION MONGA B.P;: 178 MBOUDA.
LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Engagement du chercheur
Moi, KOUECHI WONTCHEU Christian Merveille, je m'engage à procéder à cette étude conformément à toutes les normes éthiques qui s'appliquent aux projets comportant la participation de sujets humains.
Consentement du participant
Je, [nom du participant], confirme avoir lu et compris la notice d’information au sujet du projet des déterminants de la résilience chez personnes souffrantes de maladie chronique dans les hôpitaux dans la ville de Mbouda. J’ai bien saisi les conditions, les risques et les bienfaits éventuels de ma participation. On a répondu à toutes mes questions à mon entière satisfaction. J'ai disposé de suffisamment de temps pour réfléchir à ma décision de participer ou non à cette recherche. Je comprends que ma participation est entièrement volontaire et que je peux décider de me retirer en tout temps, sans aucun préjudice.
J’accepte donc librement de participer à ce projet de recherche
Date et signature du participant Date et signature du chercheur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Chronogramme des activités Budget de l’étude
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Légende;: FCFA = Franc des Colonies Françaises d’Afrique
Retranscription de verbatim relatif aux ressources personnelles de la résilience
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Retranscription de verbatim relatif aux ressources contextuelles de la résilience
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Table des matières
SOMMAIRE
DÉDICACE
Remerciements
Liste des abréviations, acronymes et sigles
Listes des figures
Liste des tableaux
Résumé
Abstract
Introduction
Chapitre 1 : État de la question
1.1 Contexte de l’étude
1.2 Énoncé du problème
1.3 Problématique
1.4 Intérêt de la recherche
Chapitre 2;: Cadre de l’étude
2.1 Définition des concepts
2.1.1 Maladies chroniques
2.1.2 La résilience
2.1.4 Controverse entre résilience et ses concepts connexes
2.1.5 Facteurs de résilience
2.1.6 La résilience et la maladie chronique
2.1.7 Pratique infirmière et résilience
2.2 Cadre théorique
2.3 Récensions des écrits
Chapitre 3;: Approche méthodologique
3.1 Présentation du lieu de l’étude Notre étude s’est déroulée dans les hôpitaux de la ville de Mbouda à savoir;:
3.1.1 L’hôpital de district de MBOUDA
3.1.2 L’hôpital AD-LUCEM de Mbouda
3.1.3 L’hôpital Protestant de Montchio de Mbouda
3.2 Justification du choix du lieu de l’étude
3.3 Méthodologie
3.3.1 Type de recherche
3.3.2 Méthode de recherche
3.3.3 Populations d’enquête
3.3.4 Critère du choix des répondants
3.3.5 Technique d’échantillonnage
3.3.6 Taille de l’échantillon
3.3.7 Collecte des données
3.3.8 Analyse des données
3.3.9 Considérations éthiques
3.3.10 Limites de l’étude
3.3.11 Communication des résultats
Chapitre 4;: Présentation et analyse des résultats
4.1 Caractéristiques sociodémographiques des participants
4.2 Les ressources personnelles dans le processus de résilience
4.3 Les ressources contextuelles dans le processus de résilience
Chapitre 5: Synthèse et discussion des résultats
5.1 Données relatives à la présentation générale des enquêtés
5.2 Données relatives aux ressources personnelles dans le processus de résilience
5.3 Données relatives aux ressources contextuelles dans le processus de résilience
Conclusion
Suggestions formulées au regard des problèmes
Références Bibliographiques
Annexes
Foire aux questions - Déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique
De quoi parle ce document ?
Ce document est une étude sur les déterminants de la résilience chez les personnes souffrant de maladies chroniques, menée dans les hôpitaux de la ville de Mbouda. Il explore les ressources personnelles et contextuelles qui contribuent à la résilience de ces individus.
Qu'est-ce que la résilience dans le contexte de cette étude ?
La résilience est définie comme la capacité d'une personne à se développer et à se projeter dans l'avenir malgré des événements déstabilisants, des conditions de vie difficiles ou des traumatismes. Dans le contexte de cette étude, elle se réfère à la capacité des personnes atteintes de maladies chroniques à s'adapter et à maintenir une qualité de vie malgré leur condition.
Quels sont les lieux où s'est déroulée l'étude ?
L'étude a été menée dans trois hôpitaux de la ville de Mbouda : l'Hôpital de District de Mbouda (HD Mbouda), l'Hôpital AD-Lucem de Mbouda (HA-D Mbouda), et l'Hôpital Protestant de Montchio de Mbouda (HP Mbouda).
Quel est le type de recherche utilisé dans cette étude ?
Il s'agit d'une recherche qualitative descriptive, utilisant la méthode clinique pour recueillir des informations auprès des participants.
Comment les participants ont-ils été sélectionnés pour cette étude ?
Les participants ont été sélectionnés en utilisant une échelle de résilience de Wagnild et Young (1993) pour identifier les personnes résilientes vivant avec des maladies chroniques, suivie d'entretiens semi-directifs.
Quels sont les principaux résultats concernant les ressources personnelles de résilience ?
Les principales ressources personnelles de résilience identifiées sont : une bonne estime de soi (autonomie), la prière, l'hyper-optimisme, les expériences de vie, et le positivisme.
Quels sont les principaux résultats concernant les ressources contextuelles de résilience ?
Les principales ressources contextuelles de résilience identifiées sont : une bonne approche dans l'annonce de la maladie, une bonne cohésion familiale, une bonne communication, et la prise en soin financière et psychologique.
Quelle est la conclusion principale de cette étude ?
La conclusion principale est que la résilience des personnes souffrant de maladies chroniques est influencée par une combinaison de ressources personnelles et contextuelles. La prise en charge devrait inclure un environnement qui promeut ces ressources.
Quelles sont les limites de cette étude ?
Les limites de l'étude incluent un manque de ressources documentaires dans le contexte camerounais et le fait que l'étude a été menée uniquement dans la ville de Mbouda, ce qui limite la généralisation des résultats.
Quelles sont les suggestions formulées à la lumière des problèmes rencontrés ?
Les suggestions incluent l'amélioration de la qualité de la relation soignant-soigné, la réduction et la prévention des risques de complications, et la réduction des coûts de soins. Il est également suggéré de renforcer le soutien psychologique et l'éducation thérapeutique des patients.
Quels types de maladies chroniques sont concernés par cette étude ?
L'étude concerne les maladies cardiaques et vasculaires (hypertension artérielle), les maladies endocriniennes (diabète), les maladies neurologiques et musculaires (antécédent d'accident vasculaire cérébral (AVC)), les maladies rhumatologiques (polyarthrite rhumatoïde) et les maladies du système digestif (gastrite chronique).
Details
- Titel
- Déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique
- Veranstaltung
- Projet tutoré
- Note
- 18,00
- Autor
- Christian Merveille Kouechi Wontcheu (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 97
- Katalognummer
- V978271
- ISBN (eBook)
- 9783346335760
- ISBN (Buch)
- 9783346335777
- Sprache
- Französisch
- Anmerkungen
- La prise en charge d'une maladie chronique est un long processus à résultats variable. Elle en appelle non seulement à une prise en charge holistique pluridisciplinaire mais aussi à l'amélioration optimale des résultats souhaités. La résilience ou du moins l'approche de la résilience dans la prise en charge d'une chronicité se veut être le moyen le plus efficace et efficient d'un dénouement heureux dans la lutte quotidienne d'une maladie à caractère chronique. Les soutiendrait l'action de l'équipe soignante, une fois les ressources trouvées selon le paradigme de la transformation.
- Schlagworte
- Déterminants Résilience Maladie Chronique Mbouda
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Christian Merveille Kouechi Wontcheu (Autor:in), 2020, Déterminants de la résilience chez les personnes souffrantes de maladie chronique, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/978271
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-